-
Maheu Le Gronnais (14..-1496)
Maheu Le Gronnais est le fils de Didier Le Gronnais dit Volgenel et de Isabelle de Heu. Il occupe la fonction de chanoine de la cathédrale avant d'entreprendre une carrière municipale comme membre du paraige de Jurue à partir de 1462, bien qu'il semble avoir été inscrit d'abord au paraige de Porsaillis comme son père.
Il est le premier et seul époux connu de Marguerite Georges avec qui il se marie à une date inconnu avant 1477. Elle le laisse veuf en 1490. Il décède le 23 avril 1496.
-
Maheu Roucel (14..-14..)
Maheu Roucel est le fils de Nicolle Roucel de Neufbourg et de Jacomette de Heu. Il poursuite une carrière ecclésiastique et est chanoine de la cathédrale de Metz, documenté en 1444. Il meurt à une date inconnue après 1465.
-
Mangette Ragait (14..-1526)
Mangette Ragait, ou Raget, est religieuse cistercienne au prieuré du « Petit Clairvaux ». En 1495, elle est élue 11e prieure. Elle construit un nouveau cloître dans le couvent. Elle meurt le 14 février 1526 selon son épitaphe, mais le 9 février 1525 selon l'obituaire du couvent.
-
Martin d'Amance (13..-1409)
Martin d'Amance est sans doute originaire de Mamey, dans le diocèse de Toul (Meurthe-et-Moselle). Il devient frère dominicain au couvent de Toul. Il occupe la fonction d'Inquisiteur dans les diocèses de Metz, Toul, Verdun et Besançon. Il est possible qu'il soit lié à la première affaire de sorcellerie documentée à Metz en 1372, quand plusieurs bourgeois sont condamnés et brûlés pour divination.
En 1381, l'évêque de Toul en fait son suffragant (évêque chargé de suppléer l'évêque en titre au spirituel), avec le titre d'évêque de Gabala. Il devient par la suite évêque suffragant de Metz pour Pierre de Luxembourg (1384-1387) puis Raoul de Coucy (1387-1415).
Il meurt le 21 octobre 1409. Son testament et l'inventaire de ses biens, dont sa riche bibliothèque, ont été édités et étudiés par Tribout de Morembert.
-
 Martin Pinguet (14..1542)
Martin Pinguet (14..1542) Martin Pinguet est un chanoine de la cathédrale de Metz, originaire de Touraine. Il habitait une maison rue des Clercs. Riche et très influent, il est pris pour cible lors des émeutes anticléricales de 1525 et sa maison est saccagée : en témoigne un capitulaire de 1526 où il demande au chapitre de reconstruire sa toiture.
Intermédiaire de la maison de Lorraine pour l'achèvement des travaux du nouveau chœur de la cathédrale, il est représenté sur une des verrières, en position de prieur, à côté de ses armes parlantes : d'azur au pingouin. Il est mort en 1542 et enterré dans la cathédrale de Metz. Sa tombe fut redécouverte en 1914 : on y découvrit un calice d'étain et d'argent et une patène.
-
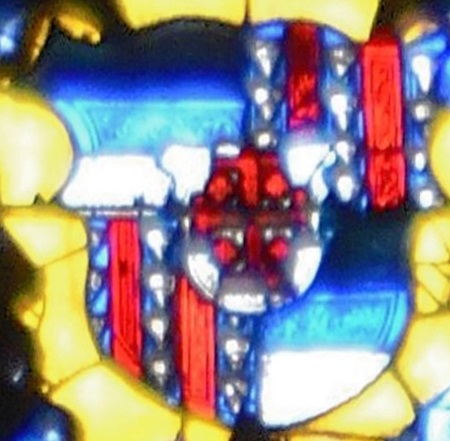 Matthias Henner (14..-1528)
Matthias Henner (14..-1528) Matthias Henner ou Thenner est un clerc d'origine germanique, docteur en droit ; il est chanoine de Metz de 1502 à 1528. Il est cerchier en 1512, archidiacre de Sarrebourg en 1514, puis official à Vic en 1515. Il succède à Jacques d'Insming comme vicaire épiscopal.
Il contribue aux grands travaux de la cathédrale en participant à la construction du jubé. En 1524, il offre un vitrail qui est installé dans la chapelle Saint-Joseph, dans l'abside. Sur ce vitrail identifié par Guillaume Frantzwa à partir de ses armoiries, il est vêtu en chanoine mais se présente comme chevalier de l'ordre du Saint-Sépulcre de Jérusalem, alors même que cet ordre de moines soldats a été fusionné avec les chevaliers de Saint-Jean (futur ordre de Malte) en 1489.
Matthias Henner meurt le 10 janvier 1528.
-
Matthieu Rembal (13..-14..)
Matthieu (ou Mattheus en latin) Rembal est un chanoine de la cathédrale de Metz. Avant 1408, il habite la maison canoniale n°16, place de Chambre. Il meurt à une date inconnue.
-
Michel Garin (14..-1512)
Michel Garin est originaire du diocèse de Toul et maître ès arts. Il est reçu chanoine de Metz en 1477. Il réside dans la maison canoniale n°14, située rue au Blé, entre 1477 et 1512. En 1507, il est mentionné comme maître de l'ouvrage de la cathédrale en pleine reconstruction. Il meurt le 17 mars 1512 et est inhumé dans la cathédrale.
Un chanoine nommé Michel est mentionné comme parrain de Jean, fils de Philippe de Vigneulles et de Zabeline Le Sarte en 1498 : il s'agit probablement de Michel Garin.
-
Michel Le Boux (14..-1517)
Michel le Boux est un chanoine de la cathédrale de Metz. Il achète la maison canonicale n°3, appelée la Haute-Pierre en 1512. Il y meurt en 1517.
-
Nemmery Baudoche (1...-1359)
Nemmery Baudoche est l'un des fils de Pierre ou Perrin Baudoche et d'une certaine Ermengarde. Comme son oncle homonyme, il devient chanoine de la cathédrale Saint-Étienne, en 1314. Il meurt le 29 mai 1359. Son corps est enseveli dans la cathédrale.
-
Nemmery Baudoche (12..-1328)
Nemmery Baudoche est le fils de Nicolle Baudoche et d'une mère inconnue. Il devient chanoine de la cathédrale et occupe la fonction de grand aumônier. Il acquiert la maison du Voué au bénéfice du chapitre : une partie du bâtiment sert à la grande aumônerie, dont la chapelle Saint-Nicolas est desservie par un chapitre de clercs ; le reste est converti en maisons canoniales. Cette fondation donne lieu à une légende postérieure, la légende du Voué, où saint Nicolas sauve de la mort un serviteur de Nemmery Baudoche. Il meurt en 1328.
Son neveu homonyme, également chanoine de la cathédrale, fonde une chapellenie en sa mémoire.
-
Nicolas Bonmarien (14..-1510)
Nicolas Bonmarien est originaire de Sainte-Menehould (Marne actuelle) au diocèse de Verdun. Chanoine de la cathédrale de Besançon en 1488, il est reçu chanoine de la cathédrale de Metz et écolâtre en 1492. Il est également chanoine de Verdun en 1498. Il habite la maison canoniale n°5 rue des Prêcheurs dès 1500. Il meurt le 14 février 1510.
-
Nicolas de Cappella (14..-15..)
Nicolas de Cappella est un chanoine de la cathédrale de Metz. En 1513, il est trésorier du chapitre, succédant à Jean Philippi.
-
Nicolas de Sarrebruck (13..-1382)
Nicolas de Sarrebruck est un chanoine de la cathédrale de Metz. Il devient archidiacre de Sarrebourg et réside dans la maison canoniale, dite de Longecourt, de 1371 à sa mort en mai 1382.
-
Nicolas Richard de Loupmont (1...-1573)
Nicolas Richard de Loupmont est un chanoine de la cathédrale de Metz. Il occupe la dignité de primicier dès 1528 et jusqu'à sa mort en 1573. Il habite dès lors la Princerie (maison canoniale n°1).
En 1534, il offre un vitrail à la cathédrale (baie 204), réalisé par Valentin Bousch.
Il peut être apparenté au chanoine Thomas Richart, mort en 1514.
-
Nicolas Toussaint (14..-1520)
Nicolas Toussaint est originaire de Saint-Laurent, dans le diocèse de Verdun (Meuse actuelle). Il est chanoine de la cathédrale de Metz et aumônier en 1501. De 1501 à 1505, il loge à l'Aumônerie. En 1505, il est en litige avec le légat pontifical Raymond Perrault, au sujet de la dignité de primicier. Toussaint perd son procès mais la mort de Perrault lui permet d'acquérir le titre de primicier et la maison de la Princerie. Il meurt à Rome le 5 août 1520 ; son inventaire après décès a été conservé.
-
Nicolle Baudoche (14..-1547)
Nicolle Baudoche est un des trois fils de Pierre Baudoche et de Bonne de la Marck. Il est chanoine de la cathédrale de Metz et accède à la dignité de grand aumônier. Avec ses frères, il fonde la chapelle Saint-Nicolas dans l'église Saint-Martin, selon les dernières volontés de leur père. Il meurt le 2 février 1547.
-
Nicolle de Châlons (1...-1393)
Nicole de Châlons est un chanoine de la cathédrale de Metz dès 1337 et jusqu'à sa mort en 1393. Il est l'oncle de Jacomin de Châlons, clerc des Treize. Les Châlons deviennent une « dynastie » de secrétaires municipaux à Metz, jusqu'à la mort de Jacomin, petit-fils du premier, alors que la charge de clerc des Treize est vendue à son gendre Gillet Le Bel, qui a épousé sa fille Alixon de Châlons.
-
 Nicolle Desch (1414-1477)
Nicolle Desch (1414-1477) Nicolle Desch est le fils de Jacques I Desch et de Poince de Vy. Il naît vers 1414. Il part de Metz vers l'âge de 15 ans faire ses études dans les universités d'Allemagne et d'italie : il est à Heidelberg en 1429, à Cologne à partir de 1431, à Pavie en 1438, enfin à Bologne en 1440-1442. En 1442, après avoir été recteur de l'université de Bologne, il devient docteur en droit romain (« décret »). Chanoine de Metz dès 1428, il est élu trésorier du chapitre cathédral de Metz pendant ses études, en 1435. Il obtient une prébende de chanoine en 1455 et la charge de chantre en 1460. Il est le dernier à obtenir l'office de trésorier, qui est supprimé après sa mort survenue le 27 juin 1477.
Il était également chanoine de la cathédrale de Verdun, bénéfice qu'il résigne en 1464 en faveur d'un ancien camarade de l'université de Cologne.
-
Nicolle Jean de Neufchâteau (1...-14..)
Nicole Jean est un prêtre originaire de la ville de Neufchâteau, dans le duché de Lorraine. À Metz, il est curé de la paroisse Saint-Victor de 1431 à 1437. Sans doute ensuite, mais avant 1452, il est curé de Nomeny, dans le temporel de l'évêché de Metz. De 1439 à 1449, il est mentionné comme curé de la grande paroisse de Saint-Simplice. En 1452, il est mentionné comme doyen de la collégiale Saint-Thiébaut ; en 1453, il est à nouveau mentionné comme curé de Saint-Simplice, cumulant donc une charge honorifique avec un bénéfice de curé. Il possède encore ces deux bénéfices en 1461. En 1466, apogée de sa carrière, il est official, juge du tribunal de l'évêque.
Amateur de théâtre, Nicolle Jean joue le rôle de Jésus dans un grand mystère joué sur la place du Change en juillet 1437. Lors de la crucifixion, il fait un malaise, si bien qu'on doit le remplacer. Le lendemain, il joue à nouveau pour la résurrection, à la satisfaction de tous. En septembre de la même année, il joue dans un autre mystère le personnage de l'empereur Titus.
Le 18 janvier 1461, il compose un bref texte en l'honneur de Jeanne d'Arc, intitulé « Abrégé des chroniques de Charles VII ». Comme le texte circule en Lorraine sous son nom de doyen de Saint-Thiébaut tout en étant associé à la chronique de son confrère Pierre de Saint-Dizier, curé de Saint-Eucaire, on a longtemps cru que le doyen de Saint-Thiébaut était l'auteur de la chronique.
-
Nicolle Le Gronnais dit le bon Abbé (13..-1452)
Nicolle le Gronnais est abbé de Saint-Vincent de 1435 à 1452. Il meurt le 22 mai 1452. Une inscription placée sur un pilier du chœur rappelle ses mérites : il a reconstruit l'église abbatiale et le cloître, remboursé les dettes de l'abbaye et est parti en pèlerinage à Rome puis à Jérusalem en 1450-1451.
-
Olric des Hazards (14..-1527)
Olric de Hazards est un chanoine de la cathédrale de Metz, sans doute apparenté à l'évêque de Toul Hugues des Hazards, à qui il succède comme doyen du chapitre de Metz. Selon Mgr Pelt dans les registres capitulaires, Olric des Hazards réclame en vain la restitution de 24 livres qu'il a payé pour son repas et doit verser les 20 livres qu'il doit comme droit d'entrée pour son statut de doyen le 22 novembre 1521. Il meurt en 1527 ; son testament a été conservé (AD Moselle G502 n°95-96).
-
Othin de Bioncourt (12..-1...)
Ce clerc messin est connu pour son activité de copiste au service de l'abbaye de Sainte-Glossinde : il réalise le cartulaire de l'abbaye en 1292, décoré d'armoiries et de sceaux, et l'année suivante la charte peinte de confirmation des privilèges.
-
Otto de Diemeringen (13..-1398)
Le chanoine Otto est sans doute originaire de Diemeringen, un village proche du comté de Sarrewerden vassal de l'évêché de Metz (Sarre-Union, Bas-Rhin). « Maître Otto » obtient le grade de maître ès arts, peut-être à l'université de Paris. Il ne semble pas avoir été prêtre, mais être resté diacre. Il devient chanoine de la cathédrale de Metz dans les années 1360. Il est accusé en 1371 d'entretenir une relation avec une femme. L'accusation ne peut pas être prouvée, mais Otto est réprimandé pour son allure non cléricale : cheveux longs, barbe, vêtements courts et chaussures pointues (à poulaines). Il est donc envoyé 14 jours dans la prison du chapitre.
Otto de Diemeringen cumule son bénéfice de chanoine avec la charge de prévôt de la collégiale de Sarrebourg.
Il est connu pour avoir traduit le "Livre des Merveilles" de Jean de Mandeville en allemand. Ce texte décrit la Terre en se présentant comme un voyage universel. Rédigé à Liège au milieu du XIVe siècle, il connait un énorme succès dans toute l'Europe. La version d'Otto est une des deux qui circulent en Allemagne à partir de la fin du XIVe siècle.
Otto meurt le 24 août 1398 et est enterré dans la cathédrale. Sa tombe est fouillée en 1914.
-
Otton Blanchard (14..-14..)
Otton Blanchard est le fils de Jean Blanchard et de Béatrice Gérardin. Ce prêtre séduit et enlève une veuve messine, Péronne, à l'automne 1497, ce qui l'entraîne dans un bras de fer entre les autorités municipales et les autorités épiscopales. Il meurt à une date inconnue.
 Martin Pinguet (14..1542) Martin Pinguet est un chanoine de la cathédrale de Metz, originaire de Touraine. Il habitait une maison rue des Clercs. Riche et très influent, il est pris pour cible lors des émeutes anticléricales de 1525 et sa maison est saccagée : en témoigne un capitulaire de 1526 où il demande au chapitre de reconstruire sa toiture. Intermédiaire de la maison de Lorraine pour l'achèvement des travaux du nouveau chœur de la cathédrale, il est représenté sur une des verrières, en position de prieur, à côté de ses armes parlantes : d'azur au pingouin. Il est mort en 1542 et enterré dans la cathédrale de Metz. Sa tombe fut redécouverte en 1914 : on y découvrit un calice d'étain et d'argent et une patène.
Martin Pinguet (14..1542) Martin Pinguet est un chanoine de la cathédrale de Metz, originaire de Touraine. Il habitait une maison rue des Clercs. Riche et très influent, il est pris pour cible lors des émeutes anticléricales de 1525 et sa maison est saccagée : en témoigne un capitulaire de 1526 où il demande au chapitre de reconstruire sa toiture. Intermédiaire de la maison de Lorraine pour l'achèvement des travaux du nouveau chœur de la cathédrale, il est représenté sur une des verrières, en position de prieur, à côté de ses armes parlantes : d'azur au pingouin. Il est mort en 1542 et enterré dans la cathédrale de Metz. Sa tombe fut redécouverte en 1914 : on y découvrit un calice d'étain et d'argent et une patène.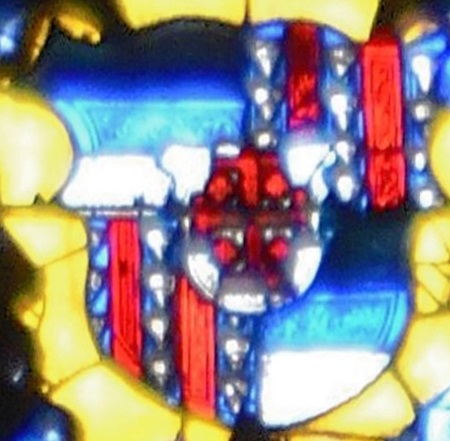 Matthias Henner (14..-1528) Matthias Henner ou Thenner est un clerc d'origine germanique, docteur en droit ; il est chanoine de Metz de 1502 à 1528. Il est cerchier en 1512, archidiacre de Sarrebourg en 1514, puis official à Vic en 1515. Il succède à Jacques d'Insming comme vicaire épiscopal. Il contribue aux grands travaux de la cathédrale en participant à la construction du jubé. En 1524, il offre un vitrail qui est installé dans la chapelle Saint-Joseph, dans l'abside. Sur ce vitrail identifié par Guillaume Frantzwa à partir de ses armoiries, il est vêtu en chanoine mais se présente comme chevalier de l'ordre du Saint-Sépulcre de Jérusalem, alors même que cet ordre de moines soldats a été fusionné avec les chevaliers de Saint-Jean (futur ordre de Malte) en 1489. Matthias Henner meurt le 10 janvier 1528.
Matthias Henner (14..-1528) Matthias Henner ou Thenner est un clerc d'origine germanique, docteur en droit ; il est chanoine de Metz de 1502 à 1528. Il est cerchier en 1512, archidiacre de Sarrebourg en 1514, puis official à Vic en 1515. Il succède à Jacques d'Insming comme vicaire épiscopal. Il contribue aux grands travaux de la cathédrale en participant à la construction du jubé. En 1524, il offre un vitrail qui est installé dans la chapelle Saint-Joseph, dans l'abside. Sur ce vitrail identifié par Guillaume Frantzwa à partir de ses armoiries, il est vêtu en chanoine mais se présente comme chevalier de l'ordre du Saint-Sépulcre de Jérusalem, alors même que cet ordre de moines soldats a été fusionné avec les chevaliers de Saint-Jean (futur ordre de Malte) en 1489. Matthias Henner meurt le 10 janvier 1528. Nicolle Desch (1414-1477) Nicolle Desch est le fils de Jacques I Desch et de Poince de Vy. Il naît vers 1414. Il part de Metz vers l'âge de 15 ans faire ses études dans les universités d'Allemagne et d'italie : il est à Heidelberg en 1429, à Cologne à partir de 1431, à Pavie en 1438, enfin à Bologne en 1440-1442. En 1442, après avoir été recteur de l'université de Bologne, il devient docteur en droit romain (« décret »). Chanoine de Metz dès 1428, il est élu trésorier du chapitre cathédral de Metz pendant ses études, en 1435. Il obtient une prébende de chanoine en 1455 et la charge de chantre en 1460. Il est le dernier à obtenir l'office de trésorier, qui est supprimé après sa mort survenue le 27 juin 1477. Il était également chanoine de la cathédrale de Verdun, bénéfice qu'il résigne en 1464 en faveur d'un ancien camarade de l'université de Cologne.
Nicolle Desch (1414-1477) Nicolle Desch est le fils de Jacques I Desch et de Poince de Vy. Il naît vers 1414. Il part de Metz vers l'âge de 15 ans faire ses études dans les universités d'Allemagne et d'italie : il est à Heidelberg en 1429, à Cologne à partir de 1431, à Pavie en 1438, enfin à Bologne en 1440-1442. En 1442, après avoir été recteur de l'université de Bologne, il devient docteur en droit romain (« décret »). Chanoine de Metz dès 1428, il est élu trésorier du chapitre cathédral de Metz pendant ses études, en 1435. Il obtient une prébende de chanoine en 1455 et la charge de chantre en 1460. Il est le dernier à obtenir l'office de trésorier, qui est supprimé après sa mort survenue le 27 juin 1477. Il était également chanoine de la cathédrale de Verdun, bénéfice qu'il résigne en 1464 en faveur d'un ancien camarade de l'université de Cologne.