-
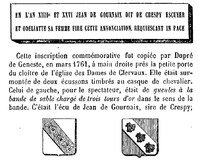 Annonciation de Jean Le Gronnais et d'Odeliette Augustaire
Annonciation de Jean Le Gronnais et d'Odeliette Augustaire Jean Le Gronnais et sa femme Odeliette Augustaire ont donné un bas-relief de l'Annonciation au Petit-Clairvaux en 1426. Sous la sculpture, l'inscription commémorative était gravée en lettres peintes en noir et surmontée des écus des deux familles Le Gronnais et Augustaire.
Le monument n'est connu que par des mentions. En 1761, Henri-Marie Dupré de Geneste relève l'inscription, mais son manuscrit (Metz, Bibliothèques-médiathèques, ms. 967) est détruit en 1944. En 1866, alors que le couvent est en cours de démolition, Ernest de Bouteiller édite une partie des mentions de Dupré de Geneste (1866, p. 65). Cependant, il identifie à tort l'épouse de Jean Le Gronnais comme Odeliette de Heu, les armoiries des Heu et des Augustaires étant très semblables.
-
 Armoiries de Claude Baudoche (église de Sainte-Barbe)
Armoiries de Claude Baudoche (église de Sainte-Barbe) Ce médaillon porte les armoiries de la famille Baudoche, en référence à Claude Baudoche, qui a reconstruit l'église Sainte-Barbe. Il appartenait peut-être à une clé de voûte. Après la destruction de l'église, il a été replacé sur le mur nord de l'église actuelle après 1826. Deux griffons servent de supports d'armes. L'écu ne contient que deux tours en chef.
-
 Armoiries de Yolande de Croy (église de Sainte-Barbe)
Armoiries de Yolande de Croy (église de Sainte-Barbe) Ce médaillon porte les armoiries de Yolande de Croy, la seconde épouse de Claude Baudoche. Il appartenait peut-être à une clé de voûte. Après la destruction de l'église, il a été replacé sur la façade de l'église actuelle, à droite de l'entrée. Deux lions ailés servent de supports d'armes ; le losange signifie que ce blason est détenu par une femme. À droite, il porte les armes de son mari, Claude Baudoche et à gauche, celle de son père, Jean de Croÿ.
-
 Buste d'homme à l'antique (Maison des têtes)
Buste d'homme à l'antique (Maison des têtes) Ce buste en haut-relief est une des cinq sculptures qui ont donné leur nom à la « Maison des têtes » au 33 en Fournirue, et qui étaient disposés sur le tympan de la fenêtre de l'étage noble de la maison. L'homme barbu a la chevelure bouclée retenue par une bandelette nouée sur la nuque et retombant sur l'épaule droite. Le vêtement, laissant la gorge dégagée, est retenu sur l'épaule gauche par une fibule ovale. Cette représentation à l'antique illustre la passion pour l'Antiquité des propriétaires de la maison. Le style de l'œuvre est proche de celui du sculpteur Ligier Richier, à qui on l'attribue parfois. Détaché de son architecture en 1913, ce buste avait été complété d'une base additionnelle (épaules et dos) permettant une présentation isolée, à la verticale, alors que l'originale était oblique par rapport à la fenêtre.
-
 Buste d'un Français (Maison des têtes)
Buste d'un Français (Maison des têtes) Ce buste en haut-relief est une des cinq sculptures qui ont donné leur nom à la « Maison des têtes » au 33 en Fournirue, et qui étaient disposés sur le tympan de la fenêtre de l'étage noble de la maison. Il s'agit du buste central de la façade. Le personnage est vêtu à la mode française de la Renaissance : il porte un chapeau large, une veste en tulle et une cape, ainsi qu'un médaillon circulaire autour du cou. Les bustes ont été déposés et vendus en 1913 : la maison est démolie au cours des années 1970 lors de la construction du centre Saint-Jacques. Ce buste avait été vendu à un collectionneur américain ; acquis par la gallerie Blumka à New York, il est vendu en 1962 au banquier et collectionneur Richard Thornton Wilson III (1886-1977). Celui-ci a été un grand donateur du Museum of Fine Arts de Boston ; le buste fait partie des legs donnés au musée en 1983 par son fils Richard Thornton Wilson Junior. L'attribution du buste à Ligier Richier n'est pas retenue par les spécialistes européens.
-
 Buste de femme (maison des têtes)
Buste de femme (maison des têtes) Ce buste en haut-relief était le deuxième à droite des cinq sculptures qui ont donné leur nom à la « Maison des têtes » au 33 en Fournirue, et qui étaient disposés sur le tympan de la fenêtre de l'étage noble de la maison. La femme est tourné vers le dernier personnage à droite, donnant l'effet d'un couple en pleine discussion. Sa coiffure est retenue par un bandeau que recouvre un voile laissant émerger, à la base, deux longues nattes. la gorge est protégée par une guimpe finement plissée, et que recouvre le noeud du voile, au contact de la robe. Sur l'épaule gauche, une fibule ovale.
-
 Buste de femme à l'antique (maison des têtes)
Buste de femme à l'antique (maison des têtes) Ce buste en haut-relief est le deuxième à gauche des cinq sculptures qui ont donné leur nom à la « Maison des têtes » au 33 en Fournirue, et qui étaient disposés sur le tympan de la fenêtre de l'étage noble de la maison. Cette femme était tourné vers l'homme à l'antique à sa gauche, donnant l'effet d'un couple en pleine discussion . La femme est vêtue à l'antique, un voile recouvrant sa tête. Sa coiffure savante est relevée et nouée au sommet du front, peut-être complétée de postiches sur les oreilles. Deux longues mèches retombent sur les épaules, mèches reliées par un bandeau noué sur la gorge. Une guimpe finement plissée protège la gorge. La tête, mutilée (nez) a été restaurée de manière approximative.
-
Buste-reliquaire de saint Étienne
En 1365, l'évêque Thierry Bayer enrichit la cathédrale d'un magnifique buste-reliquaire, que on l'appelle aussi "chef" (tête) : une statue de vermeil ornée de pierres précieuses qui contient des reliques de saint Étienne, le premier des martyrs, et le saint patron de la cathédrale. La statue est donnée par l'empereur Charles IV de Luxembourg, qui le tenait lui-même du pape Urbain V.
Ce reliquaire particulièrement précieux est enrichi au long des siècles : les donateurs y accrochent des bijoux voire des pièces de monnaie. Le chanoine Jean Bourgeois donne un anneau, Hugo Mathié donne un anneau, mais aussi, une boîte en or et une statuette. Plusieurs patriciens donnent des colliers : Poince Grognat en 1417 et Nicolle Louve en 1448 ; un pendentif est offert par un Le Gronnais à une date inconnue. La servante d'un chanoine offre aussi une bague en 1535.
En 1561, le chapitre doit financer l'armée qui entre en guerre contre les protestants français : on prélève sur le "chef saint Etienne" sept pièces d'or et 33 anneaux et bagues. Un inventaire de 1567 décompte encore 21 joyaux "après le chef saint Etienne" : colliers, chaînes, anneaux et pendentifs.
-
 Cavalier et priant
Cavalier et priant Ces deux sculptures formaient peut-être un groupe. Le cavalier est vêtu d'une cotte de maille qui lui couvre tout le corps et d'une tunique sans manches. Il porte un casque, l'écu sur la poitrine et devait tenir de la main droite une lance ou une oriflamme.
Le personnage à genoux est lui aussi vêtu comme un chevalier, il a l'épée à la ceinture mais ne porte pas de casque. Il est bien plus petit que le cavalier, ce qui permet de l'identifier comme un donateur en prière devant un saint, qui serait ici saint Georges. Dans ce cas-là, la lance disparue ne transperçait pas le dragon car elle devait pointer vers le haut : le cheval devait plutôt le piétiner.
Les deux pièces ont été collectées rue du Champé au XIXe siècle. Mais on peut les rapprocher, au moins par l'iconographie, de la description du tombeau de Maheu Ruece au couvent des Dominicains : un patricien se fait représenter sur son tombeau en chevalier, priant le saint patron de la confrérie des chevaliers du Christ.
-
 Corbeau sculpté de l'ancienne école rabbinique : un moine
Corbeau sculpté de l'ancienne école rabbinique : un moine Le corbeau est une pièce d'architecture soutenant une poutre : il est typique des salles d'apparat du Moyen Âge à Metz. Le musée de la Cour d'Or conserve deux corbeaux formant une paire. Celui-ci représente un moine en buste, avec son habit de bure, sa ceinture de corde et son capuchon, le coude droit levé soutenant la poutre. Il provient de l'ancienne école rabbinique (ou « schoul ») de Metz, démolie au XIXe siècle. Selon un témoignage oral recueilli par Migette, la communauté juive de Metz aurait installé son école dans les bâtiments du premier couvent des Carmes. L'information n'est pas vérifiable, mais ces corbeaux sont un témoignage des aménagements intérieurs des maisons de Metz au XIIIe siècle.
-
 Corbeau sculpté de l'ancienne école rabbinique : une religieuse
Corbeau sculpté de l'ancienne école rabbinique : une religieuse Le corbeau est une pièce d'architecture soutenant une poutre : il est typique des salles d'apparat du Moyen Âge à Metz. Le musée de la Cour d'Or conserve deux corbeaux formant une paire. Celui-ci est fragmentaire : il représente une religieuse en buste, avec son voile et sa guimpe, le coude gauche levé soutenant la poutre. Il provient de l'ancienne école rabbinique (ou « schoul ») de Metz, démolie au XIXe siècle. Selon un témoignage oral recueilli par Auguste Migette, la communauté juive de Metz aurait installé son école dans les bâtiments du premier couvent des Carmes. L'information n'est pas vérifiable, mais ces corbeaux sont un témoignage des aménagements intérieurs des maisons de Metz au XIIIe siècle.
-
 Double buste sculpté
Double buste sculpté Ce buste double est un témoignage de l'importance de la famille Desch et il a eu une histoire compliquée. Il représente un ou de deux membres de la famille Desch, identifiables aux motifs de guimbardes parsemés sur le vêtement. Il pourrait s'agir d'un portrait double de Philippe III Desch, ou de Philippe et d'un membre de sa famille, par exemple son fils Renaud, maître-échevin en 1526 et 1529. Les deux bustes sont solidaires, une seule ceinture fait le tour des hanches qui sont communes. Les deux personnages se tournent le dos, chacun avait les bras levés. Ils portent un pourpoint à manches très larges, mais le premier est boutonné verticalement, le second l'est en diagonale. Sur cette première face, le personnage porte une dague à la ceinture. Sur la seconde, sous la manche gauche se trouvent peut-être les fragments d'un chapelet : cette face serait alors un orant, un personnage en prière. Sur cette face, le dessin de 1854 montre une escarcelle tenue à la ceinture, aujourd'hui disparue. La statue a été retrouvé près de la porte des Allemands, où Philippe III Desch a conduit d'importants travaux au début du XVIe siècle. Elle pourrait avoir orné le sommet du moineau Desch (hypothèse de Lorrain) ou la porte elle-même.
Les deux têtes ont disparu. En 1856, Boulangé les dessine et écrit : « Sa coiffure est fort originale ; elle semble consister en une draperie nouée aux angles ». Au cours du XXe siècle, le buste est conservé dans la porte des Allemands, et oublié. Il est retrouvé en 1998, sans sa tête, et déposé au musée. Il est possible que la perte de la tête ait eu lieu pendant l'occupation allemande en 1939-1945.
-
 Gaspar, le jeune roi mage
Gaspar, le jeune roi mage Cette tête est celle d'un des trois rois mages. Au XIVe siècle, on les représente de trois âges différents : ici il s'agit du jeune roi, imberbe, qu'on appelle Gaspar.
Le buste du roi d'âge moyen (Balthazar) a aussi été retrouvé.
-
 Groupe sculpté de l'apparition du Christ
Groupe sculpté de l'apparition du Christ L'Apparition de Christ est une scène aussi désignée sous l'appellation latine « Noli me tangere ». Elle représente l'apparition de Jésus-Christ, après sa résurrection, à sa disciple Marie-Madeleine. Marie, à genoux, occupe la moitié gauche de la scène ; le Christ est debout en face d'elle, séparé par un arbre qui représente le jardin où il avait été inhumé. Il montre ses plaies aux mains et au côté droit, signe de sa victoire sur la mort. La scène sculptée est entourée d'une inscription fragmentaire, qui porte la date de 1337.
Cet objet était conservé dans un domaine privé à Vitry-sur-Orne. Elle est collectée en 1930.
-
 La mort de la Vierge (XIVe siècle)
La mort de la Vierge (XIVe siècle) La Vierge Marie est sur son lit de mort. Selon la tradition, elle s'endort pour être ensuite élevée au ciel lors de l'Assomption. Elle porte une coiffe et sourit. Elle repose sous un drap, la tête sur un oreiller à pompons. La sculpture, en assez faible relief, traite la scène de façon frontale, sans perspective. Sous le sommier subsistent des niches gothiques. La statue a pu être produite pour un portail ou un jubé ; elle a ensuite été remployée pour un monument funéraire. Selon Dieudonné, elle se trouvait sur la tombe de Perrette Brady, enterrée en 1409 aux Récollets (ms. de 1770 détruit en 1944).
-
Ligier Richier, Crucifixion de Génicourt
L'église de Génicourt-sur-Meuse conserve un Christ en croix entouré de la Vierge et de saint Jean, disposés sur le retable du choeur. Ces trois sculptures en bois polychromé sont une oeuvre de la première période du sculpteur lorrain Ligier Richier. Il est possible de relier cette oeuvre, comme les vitraux, au mécénat de Renaud Le Gronnais et d'Alixette Remiat, ou de leur fils Nicolas Le Gronnais époux d'Anne du Châtelet,
-
 Mains en prière
Mains en prière Ces mains en prière sont un fragment d'une statue du Petit Clairvaux.
-
 Mains tenant un ciboire
Mains tenant un ciboire Il s'agit d'un fragment de statue en pierre de Jaumont : une main tient un ciboire, un des vases sacrés de la liturgie chrétienne, qui contient les hosties consacrées.
-
 Niche au chevalier
Niche au chevalier Cette niche est sculptée en bas-relief : on y voit un chevalier tenant un bouclier, la lance en arrêt et les pieds tendus dans les étriers, comme s'il allait charger. L'homme porte un cimier de parade : il peut s'agir d'un tournoi plus que d'une bataille. La sculpture s'inscrit dans une niche gothique sommée d'un fleuron, qui est elle-même surmontée de trilobes et de quadrilobes.
Le bas-relief était installé sur une des maisons de la place de Chambre, aux n°6-8, où se trouvait au XIXe siècle l'Hôtel de Paris, mais qui était précédemment le site d'une maison canoniale (n°15). Après son entrée dans les collections du musée, l'oeuvre a été dessinée par Lorrain (planche 16 du catalogue manuscrit).
-
 Relief sculpté
Relief sculpté Le relief représente un homme vêtu d'un pourpoint à la mode de la première moitié du XVIe siècle. Il se tient debout entre des pilastres et sous une coquille de style Renaissance. Le pourpoint arbore les emblèmes de la famille Desch : la guimbarde et le blason familial.
-
 Roi mage du Petit-Clairvaux
Roi mage du Petit-Clairvaux Cette statue de roi mage, qui conserve des traces de polychromie, a été trouvée en trois morceaux. Les trois rois mages sont souvent représentés comme trois hommes d'âge différent. Celui-ci est le roi d'âge moyen, il est barbu et l'on reconnaît la couronne sur sa tête et son offrande à l'enfant Jésus dans la main droite (de l'encens ou de la myrrhe). Une autre tête trouvée sur le site appartient peut-être au roi mage jeune.
-
 Saint Georges et le dragon
Saint Georges et le dragon Ce relief représente saint Georges victorieux, debout sur un dragon, libérant une princesse offerte en sacrifice à la bête qui menaçait la ville de Trébizonde. Derrière la princesse apparaît la tour d’un château où se trouve un couple royal qui observe la scène. Aux pieds de la princesse et de la tour est sculpté un gros poisson dont la présence interroge : s'agit-il de situer la scène au bord de la mer ?
Le sculpteur se désintéresse des proportions, au profit d'un rendu très fin des matières. On remarque par exemple le costume du chevalier, avec sa plume sur la tête et son écu à la croix autour du cou.
L'oeuvre a été donnée au musée dans les années 1970 et provenait à Saint-Julien-lès-Metz ; on ignore son origine. Il s'agissait probablement d'un dessus-de-porte, qui pourrait provenir d'une des maisons-fortes de l'ancien bourg de Saint-Julien : la maison-forte des Desch dans le bourg, ou les gagnages de Grimont et de Châtillon.
-
 Statue de saint Jacques
Statue de saint Jacques Selon la tradition médiévale, l'apôtre saint Jacques est figuré comme un pèlerin. Il se tient debout, il porte dans sa main droite un livre ouvert et dans l'autre main un bourdon (bâton pour la marche) et un chapelet. Au-dessus de son manteau il porte une pèlerine fermée par un mors représentant une fleur. Sur cette pèlerine et sur le rebord de son chapeau sont cousues des enseignes en forme de coquilles, qui évoquent le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle. Il porte également une gourde à son ceinturon et un sac en bandoulière. C'est le costume traditionnel des pèlerins.
-
 Statue de saint Roch
Statue de saint Roch Saint Roch est figuré en habit de pèlerin : à son chapeau pendent des insignes de pèlerinage, dont les doubles clés de Rome. Il porte un grand bâton et un sac en bandoulière, auquel un chapelet est accroché. Roch (Montpellier v. 1350-1379) est très populaire dès sa mort : fils de patricien ayant tout quitté pour devenir pèlerin itinérant en France et en Italie, il se dévoue à soigner les malades en chemin et contracte la peste. La statue le montre relevant son habit pour montrer ses plaies, qu'un ange vient soigner. À sa droite, un chien porte un pain dans sa gueule : Roch s'était réfugié dans les bois après avoir attrapé la peste et il y aurait été nourri par un chien.
-
Statue de sainte Ségolène
Cette statue de bois était placée au tympan du porche construit par le curé de Sainte-Ségolène, Thiébaut Minet. Sainte Ségolène est représentée en abbesse : elle tient dans sa main droite une crosse symbolisant le gouvernement de sa communauté, et dans sa main gauche un livre, symbolisant son enseignement. Sur le livre est posé un cœur, qui témoigne de l'intensité de sa foi.
Déposée lors de la démolition du porche en 1896-1898, la statue a été restaurée et la crosse, qui avait disparue, a été restituée. Elle a été classée Monument historique en 1969.
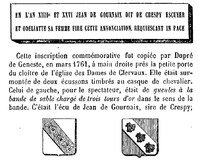 Annonciation de Jean Le Gronnais et d'Odeliette Augustaire Jean Le Gronnais et sa femme Odeliette Augustaire ont donné un bas-relief de l'Annonciation au Petit-Clairvaux en 1426. Sous la sculpture, l'inscription commémorative était gravée en lettres peintes en noir et surmontée des écus des deux familles Le Gronnais et Augustaire. Le monument n'est connu que par des mentions. En 1761, Henri-Marie Dupré de Geneste relève l'inscription, mais son manuscrit (Metz, Bibliothèques-médiathèques, ms. 967) est détruit en 1944. En 1866, alors que le couvent est en cours de démolition, Ernest de Bouteiller édite une partie des mentions de Dupré de Geneste (1866, p. 65). Cependant, il identifie à tort l'épouse de Jean Le Gronnais comme Odeliette de Heu, les armoiries des Heu et des Augustaires étant très semblables.
Annonciation de Jean Le Gronnais et d'Odeliette Augustaire Jean Le Gronnais et sa femme Odeliette Augustaire ont donné un bas-relief de l'Annonciation au Petit-Clairvaux en 1426. Sous la sculpture, l'inscription commémorative était gravée en lettres peintes en noir et surmontée des écus des deux familles Le Gronnais et Augustaire. Le monument n'est connu que par des mentions. En 1761, Henri-Marie Dupré de Geneste relève l'inscription, mais son manuscrit (Metz, Bibliothèques-médiathèques, ms. 967) est détruit en 1944. En 1866, alors que le couvent est en cours de démolition, Ernest de Bouteiller édite une partie des mentions de Dupré de Geneste (1866, p. 65). Cependant, il identifie à tort l'épouse de Jean Le Gronnais comme Odeliette de Heu, les armoiries des Heu et des Augustaires étant très semblables. Armoiries de Claude Baudoche (église de Sainte-Barbe) Ce médaillon porte les armoiries de la famille Baudoche, en référence à Claude Baudoche, qui a reconstruit l'église Sainte-Barbe. Il appartenait peut-être à une clé de voûte. Après la destruction de l'église, il a été replacé sur le mur nord de l'église actuelle après 1826. Deux griffons servent de supports d'armes. L'écu ne contient que deux tours en chef.
Armoiries de Claude Baudoche (église de Sainte-Barbe) Ce médaillon porte les armoiries de la famille Baudoche, en référence à Claude Baudoche, qui a reconstruit l'église Sainte-Barbe. Il appartenait peut-être à une clé de voûte. Après la destruction de l'église, il a été replacé sur le mur nord de l'église actuelle après 1826. Deux griffons servent de supports d'armes. L'écu ne contient que deux tours en chef. Armoiries de Yolande de Croy (église de Sainte-Barbe) Ce médaillon porte les armoiries de Yolande de Croy, la seconde épouse de Claude Baudoche. Il appartenait peut-être à une clé de voûte. Après la destruction de l'église, il a été replacé sur la façade de l'église actuelle, à droite de l'entrée. Deux lions ailés servent de supports d'armes ; le losange signifie que ce blason est détenu par une femme. À droite, il porte les armes de son mari, Claude Baudoche et à gauche, celle de son père, Jean de Croÿ.
Armoiries de Yolande de Croy (église de Sainte-Barbe) Ce médaillon porte les armoiries de Yolande de Croy, la seconde épouse de Claude Baudoche. Il appartenait peut-être à une clé de voûte. Après la destruction de l'église, il a été replacé sur la façade de l'église actuelle, à droite de l'entrée. Deux lions ailés servent de supports d'armes ; le losange signifie que ce blason est détenu par une femme. À droite, il porte les armes de son mari, Claude Baudoche et à gauche, celle de son père, Jean de Croÿ. Buste d'homme à l'antique (Maison des têtes) Ce buste en haut-relief est une des cinq sculptures qui ont donné leur nom à la « Maison des têtes » au 33 en Fournirue, et qui étaient disposés sur le tympan de la fenêtre de l'étage noble de la maison. L'homme barbu a la chevelure bouclée retenue par une bandelette nouée sur la nuque et retombant sur l'épaule droite. Le vêtement, laissant la gorge dégagée, est retenu sur l'épaule gauche par une fibule ovale. Cette représentation à l'antique illustre la passion pour l'Antiquité des propriétaires de la maison. Le style de l'œuvre est proche de celui du sculpteur Ligier Richier, à qui on l'attribue parfois. Détaché de son architecture en 1913, ce buste avait été complété d'une base additionnelle (épaules et dos) permettant une présentation isolée, à la verticale, alors que l'originale était oblique par rapport à la fenêtre.
Buste d'homme à l'antique (Maison des têtes) Ce buste en haut-relief est une des cinq sculptures qui ont donné leur nom à la « Maison des têtes » au 33 en Fournirue, et qui étaient disposés sur le tympan de la fenêtre de l'étage noble de la maison. L'homme barbu a la chevelure bouclée retenue par une bandelette nouée sur la nuque et retombant sur l'épaule droite. Le vêtement, laissant la gorge dégagée, est retenu sur l'épaule gauche par une fibule ovale. Cette représentation à l'antique illustre la passion pour l'Antiquité des propriétaires de la maison. Le style de l'œuvre est proche de celui du sculpteur Ligier Richier, à qui on l'attribue parfois. Détaché de son architecture en 1913, ce buste avait été complété d'une base additionnelle (épaules et dos) permettant une présentation isolée, à la verticale, alors que l'originale était oblique par rapport à la fenêtre. Buste d'un Français (Maison des têtes) Ce buste en haut-relief est une des cinq sculptures qui ont donné leur nom à la « Maison des têtes » au 33 en Fournirue, et qui étaient disposés sur le tympan de la fenêtre de l'étage noble de la maison. Il s'agit du buste central de la façade. Le personnage est vêtu à la mode française de la Renaissance : il porte un chapeau large, une veste en tulle et une cape, ainsi qu'un médaillon circulaire autour du cou. Les bustes ont été déposés et vendus en 1913 : la maison est démolie au cours des années 1970 lors de la construction du centre Saint-Jacques. Ce buste avait été vendu à un collectionneur américain ; acquis par la gallerie Blumka à New York, il est vendu en 1962 au banquier et collectionneur Richard Thornton Wilson III (1886-1977). Celui-ci a été un grand donateur du Museum of Fine Arts de Boston ; le buste fait partie des legs donnés au musée en 1983 par son fils Richard Thornton Wilson Junior. L'attribution du buste à Ligier Richier n'est pas retenue par les spécialistes européens.
Buste d'un Français (Maison des têtes) Ce buste en haut-relief est une des cinq sculptures qui ont donné leur nom à la « Maison des têtes » au 33 en Fournirue, et qui étaient disposés sur le tympan de la fenêtre de l'étage noble de la maison. Il s'agit du buste central de la façade. Le personnage est vêtu à la mode française de la Renaissance : il porte un chapeau large, une veste en tulle et une cape, ainsi qu'un médaillon circulaire autour du cou. Les bustes ont été déposés et vendus en 1913 : la maison est démolie au cours des années 1970 lors de la construction du centre Saint-Jacques. Ce buste avait été vendu à un collectionneur américain ; acquis par la gallerie Blumka à New York, il est vendu en 1962 au banquier et collectionneur Richard Thornton Wilson III (1886-1977). Celui-ci a été un grand donateur du Museum of Fine Arts de Boston ; le buste fait partie des legs donnés au musée en 1983 par son fils Richard Thornton Wilson Junior. L'attribution du buste à Ligier Richier n'est pas retenue par les spécialistes européens. Buste de femme (maison des têtes) Ce buste en haut-relief était le deuxième à droite des cinq sculptures qui ont donné leur nom à la « Maison des têtes » au 33 en Fournirue, et qui étaient disposés sur le tympan de la fenêtre de l'étage noble de la maison. La femme est tourné vers le dernier personnage à droite, donnant l'effet d'un couple en pleine discussion. Sa coiffure est retenue par un bandeau que recouvre un voile laissant émerger, à la base, deux longues nattes. la gorge est protégée par une guimpe finement plissée, et que recouvre le noeud du voile, au contact de la robe. Sur l'épaule gauche, une fibule ovale.
Buste de femme (maison des têtes) Ce buste en haut-relief était le deuxième à droite des cinq sculptures qui ont donné leur nom à la « Maison des têtes » au 33 en Fournirue, et qui étaient disposés sur le tympan de la fenêtre de l'étage noble de la maison. La femme est tourné vers le dernier personnage à droite, donnant l'effet d'un couple en pleine discussion. Sa coiffure est retenue par un bandeau que recouvre un voile laissant émerger, à la base, deux longues nattes. la gorge est protégée par une guimpe finement plissée, et que recouvre le noeud du voile, au contact de la robe. Sur l'épaule gauche, une fibule ovale. Buste de femme à l'antique (maison des têtes) Ce buste en haut-relief est le deuxième à gauche des cinq sculptures qui ont donné leur nom à la « Maison des têtes » au 33 en Fournirue, et qui étaient disposés sur le tympan de la fenêtre de l'étage noble de la maison. Cette femme était tourné vers l'homme à l'antique à sa gauche, donnant l'effet d'un couple en pleine discussion . La femme est vêtue à l'antique, un voile recouvrant sa tête. Sa coiffure savante est relevée et nouée au sommet du front, peut-être complétée de postiches sur les oreilles. Deux longues mèches retombent sur les épaules, mèches reliées par un bandeau noué sur la gorge. Une guimpe finement plissée protège la gorge. La tête, mutilée (nez) a été restaurée de manière approximative.
Buste de femme à l'antique (maison des têtes) Ce buste en haut-relief est le deuxième à gauche des cinq sculptures qui ont donné leur nom à la « Maison des têtes » au 33 en Fournirue, et qui étaient disposés sur le tympan de la fenêtre de l'étage noble de la maison. Cette femme était tourné vers l'homme à l'antique à sa gauche, donnant l'effet d'un couple en pleine discussion . La femme est vêtue à l'antique, un voile recouvrant sa tête. Sa coiffure savante est relevée et nouée au sommet du front, peut-être complétée de postiches sur les oreilles. Deux longues mèches retombent sur les épaules, mèches reliées par un bandeau noué sur la gorge. Une guimpe finement plissée protège la gorge. La tête, mutilée (nez) a été restaurée de manière approximative. Cavalier et priant Ces deux sculptures formaient peut-être un groupe. Le cavalier est vêtu d'une cotte de maille qui lui couvre tout le corps et d'une tunique sans manches. Il porte un casque, l'écu sur la poitrine et devait tenir de la main droite une lance ou une oriflamme. Le personnage à genoux est lui aussi vêtu comme un chevalier, il a l'épée à la ceinture mais ne porte pas de casque. Il est bien plus petit que le cavalier, ce qui permet de l'identifier comme un donateur en prière devant un saint, qui serait ici saint Georges. Dans ce cas-là, la lance disparue ne transperçait pas le dragon car elle devait pointer vers le haut : le cheval devait plutôt le piétiner. Les deux pièces ont été collectées rue du Champé au XIXe siècle. Mais on peut les rapprocher, au moins par l'iconographie, de la description du tombeau de Maheu Ruece au couvent des Dominicains : un patricien se fait représenter sur son tombeau en chevalier, priant le saint patron de la confrérie des chevaliers du Christ.
Cavalier et priant Ces deux sculptures formaient peut-être un groupe. Le cavalier est vêtu d'une cotte de maille qui lui couvre tout le corps et d'une tunique sans manches. Il porte un casque, l'écu sur la poitrine et devait tenir de la main droite une lance ou une oriflamme. Le personnage à genoux est lui aussi vêtu comme un chevalier, il a l'épée à la ceinture mais ne porte pas de casque. Il est bien plus petit que le cavalier, ce qui permet de l'identifier comme un donateur en prière devant un saint, qui serait ici saint Georges. Dans ce cas-là, la lance disparue ne transperçait pas le dragon car elle devait pointer vers le haut : le cheval devait plutôt le piétiner. Les deux pièces ont été collectées rue du Champé au XIXe siècle. Mais on peut les rapprocher, au moins par l'iconographie, de la description du tombeau de Maheu Ruece au couvent des Dominicains : un patricien se fait représenter sur son tombeau en chevalier, priant le saint patron de la confrérie des chevaliers du Christ. Corbeau sculpté de l'ancienne école rabbinique : un moine Le corbeau est une pièce d'architecture soutenant une poutre : il est typique des salles d'apparat du Moyen Âge à Metz. Le musée de la Cour d'Or conserve deux corbeaux formant une paire. Celui-ci représente un moine en buste, avec son habit de bure, sa ceinture de corde et son capuchon, le coude droit levé soutenant la poutre. Il provient de l'ancienne école rabbinique (ou « schoul ») de Metz, démolie au XIXe siècle. Selon un témoignage oral recueilli par Migette, la communauté juive de Metz aurait installé son école dans les bâtiments du premier couvent des Carmes. L'information n'est pas vérifiable, mais ces corbeaux sont un témoignage des aménagements intérieurs des maisons de Metz au XIIIe siècle.
Corbeau sculpté de l'ancienne école rabbinique : un moine Le corbeau est une pièce d'architecture soutenant une poutre : il est typique des salles d'apparat du Moyen Âge à Metz. Le musée de la Cour d'Or conserve deux corbeaux formant une paire. Celui-ci représente un moine en buste, avec son habit de bure, sa ceinture de corde et son capuchon, le coude droit levé soutenant la poutre. Il provient de l'ancienne école rabbinique (ou « schoul ») de Metz, démolie au XIXe siècle. Selon un témoignage oral recueilli par Migette, la communauté juive de Metz aurait installé son école dans les bâtiments du premier couvent des Carmes. L'information n'est pas vérifiable, mais ces corbeaux sont un témoignage des aménagements intérieurs des maisons de Metz au XIIIe siècle. Corbeau sculpté de l'ancienne école rabbinique : une religieuse Le corbeau est une pièce d'architecture soutenant une poutre : il est typique des salles d'apparat du Moyen Âge à Metz. Le musée de la Cour d'Or conserve deux corbeaux formant une paire. Celui-ci est fragmentaire : il représente une religieuse en buste, avec son voile et sa guimpe, le coude gauche levé soutenant la poutre. Il provient de l'ancienne école rabbinique (ou « schoul ») de Metz, démolie au XIXe siècle. Selon un témoignage oral recueilli par Auguste Migette, la communauté juive de Metz aurait installé son école dans les bâtiments du premier couvent des Carmes. L'information n'est pas vérifiable, mais ces corbeaux sont un témoignage des aménagements intérieurs des maisons de Metz au XIIIe siècle.
Corbeau sculpté de l'ancienne école rabbinique : une religieuse Le corbeau est une pièce d'architecture soutenant une poutre : il est typique des salles d'apparat du Moyen Âge à Metz. Le musée de la Cour d'Or conserve deux corbeaux formant une paire. Celui-ci est fragmentaire : il représente une religieuse en buste, avec son voile et sa guimpe, le coude gauche levé soutenant la poutre. Il provient de l'ancienne école rabbinique (ou « schoul ») de Metz, démolie au XIXe siècle. Selon un témoignage oral recueilli par Auguste Migette, la communauté juive de Metz aurait installé son école dans les bâtiments du premier couvent des Carmes. L'information n'est pas vérifiable, mais ces corbeaux sont un témoignage des aménagements intérieurs des maisons de Metz au XIIIe siècle. Double buste sculpté Ce buste double est un témoignage de l'importance de la famille Desch et il a eu une histoire compliquée. Il représente un ou de deux membres de la famille Desch, identifiables aux motifs de guimbardes parsemés sur le vêtement. Il pourrait s'agir d'un portrait double de Philippe III Desch, ou de Philippe et d'un membre de sa famille, par exemple son fils Renaud, maître-échevin en 1526 et 1529. Les deux bustes sont solidaires, une seule ceinture fait le tour des hanches qui sont communes. Les deux personnages se tournent le dos, chacun avait les bras levés. Ils portent un pourpoint à manches très larges, mais le premier est boutonné verticalement, le second l'est en diagonale. Sur cette première face, le personnage porte une dague à la ceinture. Sur la seconde, sous la manche gauche se trouvent peut-être les fragments d'un chapelet : cette face serait alors un orant, un personnage en prière. Sur cette face, le dessin de 1854 montre une escarcelle tenue à la ceinture, aujourd'hui disparue. La statue a été retrouvé près de la porte des Allemands, où Philippe III Desch a conduit d'importants travaux au début du XVIe siècle. Elle pourrait avoir orné le sommet du moineau Desch (hypothèse de Lorrain) ou la porte elle-même. Les deux têtes ont disparu. En 1856, Boulangé les dessine et écrit : « Sa coiffure est fort originale ; elle semble consister en une draperie nouée aux angles ». Au cours du XXe siècle, le buste est conservé dans la porte des Allemands, et oublié. Il est retrouvé en 1998, sans sa tête, et déposé au musée. Il est possible que la perte de la tête ait eu lieu pendant l'occupation allemande en 1939-1945.
Double buste sculpté Ce buste double est un témoignage de l'importance de la famille Desch et il a eu une histoire compliquée. Il représente un ou de deux membres de la famille Desch, identifiables aux motifs de guimbardes parsemés sur le vêtement. Il pourrait s'agir d'un portrait double de Philippe III Desch, ou de Philippe et d'un membre de sa famille, par exemple son fils Renaud, maître-échevin en 1526 et 1529. Les deux bustes sont solidaires, une seule ceinture fait le tour des hanches qui sont communes. Les deux personnages se tournent le dos, chacun avait les bras levés. Ils portent un pourpoint à manches très larges, mais le premier est boutonné verticalement, le second l'est en diagonale. Sur cette première face, le personnage porte une dague à la ceinture. Sur la seconde, sous la manche gauche se trouvent peut-être les fragments d'un chapelet : cette face serait alors un orant, un personnage en prière. Sur cette face, le dessin de 1854 montre une escarcelle tenue à la ceinture, aujourd'hui disparue. La statue a été retrouvé près de la porte des Allemands, où Philippe III Desch a conduit d'importants travaux au début du XVIe siècle. Elle pourrait avoir orné le sommet du moineau Desch (hypothèse de Lorrain) ou la porte elle-même. Les deux têtes ont disparu. En 1856, Boulangé les dessine et écrit : « Sa coiffure est fort originale ; elle semble consister en une draperie nouée aux angles ». Au cours du XXe siècle, le buste est conservé dans la porte des Allemands, et oublié. Il est retrouvé en 1998, sans sa tête, et déposé au musée. Il est possible que la perte de la tête ait eu lieu pendant l'occupation allemande en 1939-1945. Gaspar, le jeune roi mage Cette tête est celle d'un des trois rois mages. Au XIVe siècle, on les représente de trois âges différents : ici il s'agit du jeune roi, imberbe, qu'on appelle Gaspar. Le buste du roi d'âge moyen (Balthazar) a aussi été retrouvé.
Gaspar, le jeune roi mage Cette tête est celle d'un des trois rois mages. Au XIVe siècle, on les représente de trois âges différents : ici il s'agit du jeune roi, imberbe, qu'on appelle Gaspar. Le buste du roi d'âge moyen (Balthazar) a aussi été retrouvé. Groupe sculpté de l'apparition du Christ L'Apparition de Christ est une scène aussi désignée sous l'appellation latine « Noli me tangere ». Elle représente l'apparition de Jésus-Christ, après sa résurrection, à sa disciple Marie-Madeleine. Marie, à genoux, occupe la moitié gauche de la scène ; le Christ est debout en face d'elle, séparé par un arbre qui représente le jardin où il avait été inhumé. Il montre ses plaies aux mains et au côté droit, signe de sa victoire sur la mort. La scène sculptée est entourée d'une inscription fragmentaire, qui porte la date de 1337. Cet objet était conservé dans un domaine privé à Vitry-sur-Orne. Elle est collectée en 1930.
Groupe sculpté de l'apparition du Christ L'Apparition de Christ est une scène aussi désignée sous l'appellation latine « Noli me tangere ». Elle représente l'apparition de Jésus-Christ, après sa résurrection, à sa disciple Marie-Madeleine. Marie, à genoux, occupe la moitié gauche de la scène ; le Christ est debout en face d'elle, séparé par un arbre qui représente le jardin où il avait été inhumé. Il montre ses plaies aux mains et au côté droit, signe de sa victoire sur la mort. La scène sculptée est entourée d'une inscription fragmentaire, qui porte la date de 1337. Cet objet était conservé dans un domaine privé à Vitry-sur-Orne. Elle est collectée en 1930. La mort de la Vierge (XIVe siècle) La Vierge Marie est sur son lit de mort. Selon la tradition, elle s'endort pour être ensuite élevée au ciel lors de l'Assomption. Elle porte une coiffe et sourit. Elle repose sous un drap, la tête sur un oreiller à pompons. La sculpture, en assez faible relief, traite la scène de façon frontale, sans perspective. Sous le sommier subsistent des niches gothiques. La statue a pu être produite pour un portail ou un jubé ; elle a ensuite été remployée pour un monument funéraire. Selon Dieudonné, elle se trouvait sur la tombe de Perrette Brady, enterrée en 1409 aux Récollets (ms. de 1770 détruit en 1944).
La mort de la Vierge (XIVe siècle) La Vierge Marie est sur son lit de mort. Selon la tradition, elle s'endort pour être ensuite élevée au ciel lors de l'Assomption. Elle porte une coiffe et sourit. Elle repose sous un drap, la tête sur un oreiller à pompons. La sculpture, en assez faible relief, traite la scène de façon frontale, sans perspective. Sous le sommier subsistent des niches gothiques. La statue a pu être produite pour un portail ou un jubé ; elle a ensuite été remployée pour un monument funéraire. Selon Dieudonné, elle se trouvait sur la tombe de Perrette Brady, enterrée en 1409 aux Récollets (ms. de 1770 détruit en 1944). Mains en prière Ces mains en prière sont un fragment d'une statue du Petit Clairvaux.
Mains en prière Ces mains en prière sont un fragment d'une statue du Petit Clairvaux. Mains tenant un ciboire Il s'agit d'un fragment de statue en pierre de Jaumont : une main tient un ciboire, un des vases sacrés de la liturgie chrétienne, qui contient les hosties consacrées.
Mains tenant un ciboire Il s'agit d'un fragment de statue en pierre de Jaumont : une main tient un ciboire, un des vases sacrés de la liturgie chrétienne, qui contient les hosties consacrées. Niche au chevalier Cette niche est sculptée en bas-relief : on y voit un chevalier tenant un bouclier, la lance en arrêt et les pieds tendus dans les étriers, comme s'il allait charger. L'homme porte un cimier de parade : il peut s'agir d'un tournoi plus que d'une bataille. La sculpture s'inscrit dans une niche gothique sommée d'un fleuron, qui est elle-même surmontée de trilobes et de quadrilobes. Le bas-relief était installé sur une des maisons de la place de Chambre, aux n°6-8, où se trouvait au XIXe siècle l'Hôtel de Paris, mais qui était précédemment le site d'une maison canoniale (n°15). Après son entrée dans les collections du musée, l'oeuvre a été dessinée par Lorrain (planche 16 du catalogue manuscrit).
Niche au chevalier Cette niche est sculptée en bas-relief : on y voit un chevalier tenant un bouclier, la lance en arrêt et les pieds tendus dans les étriers, comme s'il allait charger. L'homme porte un cimier de parade : il peut s'agir d'un tournoi plus que d'une bataille. La sculpture s'inscrit dans une niche gothique sommée d'un fleuron, qui est elle-même surmontée de trilobes et de quadrilobes. Le bas-relief était installé sur une des maisons de la place de Chambre, aux n°6-8, où se trouvait au XIXe siècle l'Hôtel de Paris, mais qui était précédemment le site d'une maison canoniale (n°15). Après son entrée dans les collections du musée, l'oeuvre a été dessinée par Lorrain (planche 16 du catalogue manuscrit). Relief sculpté Le relief représente un homme vêtu d'un pourpoint à la mode de la première moitié du XVIe siècle. Il se tient debout entre des pilastres et sous une coquille de style Renaissance. Le pourpoint arbore les emblèmes de la famille Desch : la guimbarde et le blason familial.
Relief sculpté Le relief représente un homme vêtu d'un pourpoint à la mode de la première moitié du XVIe siècle. Il se tient debout entre des pilastres et sous une coquille de style Renaissance. Le pourpoint arbore les emblèmes de la famille Desch : la guimbarde et le blason familial. Roi mage du Petit-Clairvaux Cette statue de roi mage, qui conserve des traces de polychromie, a été trouvée en trois morceaux. Les trois rois mages sont souvent représentés comme trois hommes d'âge différent. Celui-ci est le roi d'âge moyen, il est barbu et l'on reconnaît la couronne sur sa tête et son offrande à l'enfant Jésus dans la main droite (de l'encens ou de la myrrhe). Une autre tête trouvée sur le site appartient peut-être au roi mage jeune.
Roi mage du Petit-Clairvaux Cette statue de roi mage, qui conserve des traces de polychromie, a été trouvée en trois morceaux. Les trois rois mages sont souvent représentés comme trois hommes d'âge différent. Celui-ci est le roi d'âge moyen, il est barbu et l'on reconnaît la couronne sur sa tête et son offrande à l'enfant Jésus dans la main droite (de l'encens ou de la myrrhe). Une autre tête trouvée sur le site appartient peut-être au roi mage jeune. Saint Georges et le dragon Ce relief représente saint Georges victorieux, debout sur un dragon, libérant une princesse offerte en sacrifice à la bête qui menaçait la ville de Trébizonde. Derrière la princesse apparaît la tour d’un château où se trouve un couple royal qui observe la scène. Aux pieds de la princesse et de la tour est sculpté un gros poisson dont la présence interroge : s'agit-il de situer la scène au bord de la mer ? Le sculpteur se désintéresse des proportions, au profit d'un rendu très fin des matières. On remarque par exemple le costume du chevalier, avec sa plume sur la tête et son écu à la croix autour du cou. L'oeuvre a été donnée au musée dans les années 1970 et provenait à Saint-Julien-lès-Metz ; on ignore son origine. Il s'agissait probablement d'un dessus-de-porte, qui pourrait provenir d'une des maisons-fortes de l'ancien bourg de Saint-Julien : la maison-forte des Desch dans le bourg, ou les gagnages de Grimont et de Châtillon.
Saint Georges et le dragon Ce relief représente saint Georges victorieux, debout sur un dragon, libérant une princesse offerte en sacrifice à la bête qui menaçait la ville de Trébizonde. Derrière la princesse apparaît la tour d’un château où se trouve un couple royal qui observe la scène. Aux pieds de la princesse et de la tour est sculpté un gros poisson dont la présence interroge : s'agit-il de situer la scène au bord de la mer ? Le sculpteur se désintéresse des proportions, au profit d'un rendu très fin des matières. On remarque par exemple le costume du chevalier, avec sa plume sur la tête et son écu à la croix autour du cou. L'oeuvre a été donnée au musée dans les années 1970 et provenait à Saint-Julien-lès-Metz ; on ignore son origine. Il s'agissait probablement d'un dessus-de-porte, qui pourrait provenir d'une des maisons-fortes de l'ancien bourg de Saint-Julien : la maison-forte des Desch dans le bourg, ou les gagnages de Grimont et de Châtillon. Statue de saint Jacques Selon la tradition médiévale, l'apôtre saint Jacques est figuré comme un pèlerin. Il se tient debout, il porte dans sa main droite un livre ouvert et dans l'autre main un bourdon (bâton pour la marche) et un chapelet. Au-dessus de son manteau il porte une pèlerine fermée par un mors représentant une fleur. Sur cette pèlerine et sur le rebord de son chapeau sont cousues des enseignes en forme de coquilles, qui évoquent le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle. Il porte également une gourde à son ceinturon et un sac en bandoulière. C'est le costume traditionnel des pèlerins.
Statue de saint Jacques Selon la tradition médiévale, l'apôtre saint Jacques est figuré comme un pèlerin. Il se tient debout, il porte dans sa main droite un livre ouvert et dans l'autre main un bourdon (bâton pour la marche) et un chapelet. Au-dessus de son manteau il porte une pèlerine fermée par un mors représentant une fleur. Sur cette pèlerine et sur le rebord de son chapeau sont cousues des enseignes en forme de coquilles, qui évoquent le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle. Il porte également une gourde à son ceinturon et un sac en bandoulière. C'est le costume traditionnel des pèlerins. Statue de saint Roch Saint Roch est figuré en habit de pèlerin : à son chapeau pendent des insignes de pèlerinage, dont les doubles clés de Rome. Il porte un grand bâton et un sac en bandoulière, auquel un chapelet est accroché. Roch (Montpellier v. 1350-1379) est très populaire dès sa mort : fils de patricien ayant tout quitté pour devenir pèlerin itinérant en France et en Italie, il se dévoue à soigner les malades en chemin et contracte la peste. La statue le montre relevant son habit pour montrer ses plaies, qu'un ange vient soigner. À sa droite, un chien porte un pain dans sa gueule : Roch s'était réfugié dans les bois après avoir attrapé la peste et il y aurait été nourri par un chien.
Statue de saint Roch Saint Roch est figuré en habit de pèlerin : à son chapeau pendent des insignes de pèlerinage, dont les doubles clés de Rome. Il porte un grand bâton et un sac en bandoulière, auquel un chapelet est accroché. Roch (Montpellier v. 1350-1379) est très populaire dès sa mort : fils de patricien ayant tout quitté pour devenir pèlerin itinérant en France et en Italie, il se dévoue à soigner les malades en chemin et contracte la peste. La statue le montre relevant son habit pour montrer ses plaies, qu'un ange vient soigner. À sa droite, un chien porte un pain dans sa gueule : Roch s'était réfugié dans les bois après avoir attrapé la peste et il y aurait été nourri par un chien.