-
Tribout de Morembert, Henri, « Le testament et la bibliothèque de Martin d'Amance. Évêque suffragant de Metz (1409) »
Tribout de Morembert, Henri, « Le testament et la bibliothèque de Martin d'Amance. Évêque suffragant de Metz (1409) », Annuaire de la Société d'histoire et d'archéologie de la Lorraine vol. 67/68 (1967/68) p. 65-82.
-
Trimbur, Virginie, Liturgie et organisation de l’espace dans un groupe cathédral : le cérémonial de la cathédrale de Metz (XIIe-XIIIe siècles)
Trimbur, Virginie, Liturgie et organisation de l’espace dans un groupe
cathédral : le cérémonial de la cathédrale de Metz (XIIe-XIIIe siècles), thèse de doctorat, Université de Lille, 2018.
-
 Tympan aux dragons
Tympan aux dragons Ce tympan sculpté était situé rue de la Chèvre, au n°28, dans une maison donnant sur la cour, détruite dans les années 1970. Il en reste trois éléments sculptés au musée de la Cour d'Or : deux dragons et un personnage aux cheveux mi-longs, en tunique, qui a pu être identifiée avec sainte Constance. Une inscription fragmentaire a été relevée au XIXe siècle au-dessus : « wi.sart.iuet...? »
-
Un savetier devient évêque : la légende de saint Aultre
-
Valentin Bousch (14..-1541)
Valentin Bousch est un des plus célèbres maîtres verriers du XVIe siècle. Sans doute origine de Strasbourg, il travaille sur le chantier lorrain de Saint-Nicolas de Port avant d'être engagé par le chapitre de Metz comme verrier de la cathédrale en 1518. Il se fixe alors à Metz, vers 1520-1522. Il travaille pendant vingt ans pour le chapitre de la cathédrale, alors que la grande église est en plein chantier. Les registres capitulaires nous rapporte le marché conclu avec le maître verrier en 1520 qui devra être payé 20 denier le pied pour du blanc verre et 5 sous le pied pour du verre peint.
Il travaille aussi pour certaines familles de paraiges, notamment les Baudoche, mais ses œuvres pour les églises de Metz (comme les Carmes) ont presque entièrement disparu. Demeurent des vitraux réalisés pour les gens de paraiges dans le pays messin (à Sainte-Barbe pour les Baudoche) ou ailleurs (à Génicourt-sur-Meuse pour les Le Gronnais). Valentin habite une maison canoniale près du grenier de Chèvremont. Il dirige un atelier considérable et accumule une fortune certaine. Il meurt en 1541 et est enterré dans le cimetière de Saint-Gorgon.
-
Vanier Varnerii (14..-15..)
Vanier Varnerii est un chanoine du chapitre de la cathédrale de Metz, qui occupe la fonction de grand archidiacre. En 1510, il réside à la maison canoniale n°4, située rue des Prêcheurs.
-
Verrière du transept nord de la cathédrale Saint-Étienne
Cette verrière de la cathédrale Saint-Étienne est l'œuvre de Théobald de Lixheim, qui la signe et la date en 1504. Elle est plusieurs fois modifiée dans les siècles suivants, particulièrement au XIXe siècle : en 1879, la maison Schmidt-Reuters, puis Fritz Geiges entre 1879 et 1909, lui donnent son aspect actuel en remplaçant les lancettes de la galerie inférieure, avec les huit apôtres. Il reste est le travail Théobald de Lixheim : les vitraux du tympan, les deux registres supérieurs (huit saintes), et les registres intermédiaires (huit saints), aux têtes entièrement refaites.
Au niveau intermédiaire sont représentées les saintes Agnès, Marguerite, Marie-Madeleine, Catherine, Apolline, Odile, Élisabeth et Barbe, avec les armoiries de l’évêque Henri de Lorraine, qui offrit ces vitraux à la cathédrale de Metz. Au niveau supérieur, les huit sains sont Hubert, Michel, Antoine, Roch, Nicolas, et deux moines non identifiés. Les socles et les dais sont extrêmement développés.
Theobald a signé son œuvre sous les pieds des saintes : « HOC OPUS PER THEOBALDUM DE LYXHEIM VITRIARIUM PERFECTUM EST ANO DOMINI MCCCCCIV ». Traduction en français moderne : « Cette œuvre fut achevée par Théobald de Lixheim, verrier, en l’an du Seigneur 1504 ».
-
Verrière du transept sud de la cathédrale de Metz
Valentin Bousch réalise la verrière du transept sud de la cathédrale Saint-Étienne en deux étapes : la partie haute est financée par le chapitre de la cathédrale en 1521. Elle représente un soleil entouré d'anges. En 1525, Valentin Bousch commence les trois niveaux de lancettes. Le chanoine Evrard Marlier mort cette année-là, était lui-même l'exécuteur testamentaire de son oncle le chanoine Otto Savin, décédé un demi-siècle plus tôt. Grâce à ces legs, Bousch termine la verrière en 1527. L'œuvre est inspirée du peintre allemand Hans Baldung Grien (1484-1545). Deux séries de saints évêques de Metz, en haut et en bas, et une série de saintes, au milieu, sont présentés dans un décor d'architecture Renaissance.
-
Viansson-Ponté, Louis, Les Jésuites à Metz : Collège Saint-Louis, 1622-1762, Collège Saint Clément, 1852-1872
Viansson-Ponté, Louis, Les Jésuites à Metz : Collège Saint-Louis, 1622-1762, Collège Saint Clément, 1852-1872, Strasbourg, 1897
-
Vicaire
Le vicaire (vicarii) est une dignité ecclésiastique qui apparaît au XIe siècle. Sa fonction est d'aider les chanoines lors du chant de l'office. Leur nombre au sein de chaque collégiale varie au fil du temps : au chapitre cathédral de Metz ils sont cinq jusqu'en 1540, puis six à partir de 1546.
-
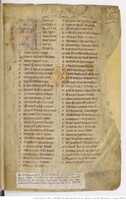 Vie des Pères, en vers (Paris, BNF, FR 20040)
Vie des Pères, en vers (Paris, BNF, FR 20040) Incertaine
-
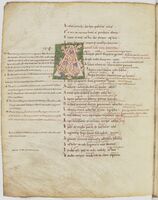 Virgile, Enéide (BnF, NAL, ms. 2059)
Virgile, Enéide (BnF, NAL, ms. 2059) Metz?
-
Virginie Trimbur (1982-)
Virginie Trimbur est historienne médiévaliste spécialisée sur la question religieuse
-
 Vitrail de Jean Bataille
Vitrail de Jean Bataille Ce vitrail commandé par Jean Bataille est attribué à l'atelier du verrier Hermann de Munster, qui travaille dans les années 1380 au chantier de la cathédrale.
Le chevalier est vêtu comme un combattant de la fin du XIVe siècle : il porte une jaque, une veste matelassée et serrée, de couleur verte. La ceinture basse (demi-ceint) faite de plaques métalliques articulées, permet d'accrocher les gantelets de fer et l'épée. Sur la tête, le chevalier porte un bassinet dont la visière est relevée. Le cou et le bas du visage sont protégés par un camail en mailles. Le bas du corps est protégé par des cuissières et des jambières, reliées par des genouillères à ailerons. Les pieds sont chaussés de solerets à poulaine et à éperons.
À genoux les mains jointes, Jean Bataille est en prière, l'inscription autour de sa tête invoque la Vierge, qui devait être figurée sur la partie droite du vitrail d'origine : « Memento queso mei Maria mater Dei Omnipotensis » (Souviens-toi de moi, je t'en prie, Marie mère du Dieu Tout-Puissant).
Jean Bataille est identifiable à ses armes situées sur l'écu en-dessous de lui, porté par deux lions. Tous ces fragments ont été remployés ensemble au XIXe siècle pour former une baie sans cohérence (baie 9) dans l'absidiole nord de l'église Saint-Ségolène. Autour de lui, les donatrices, de différentes tailles et de différentes époques, ainsi que d'autres fragments, désignées seulement par leurs prénoms, ne sont pas identifiables.
-
 Vitrail de la Flagellation du Christ
Vitrail de la Flagellation du Christ Ce vitrail aujourd'hui conservé à Londres provient d'une verrière dédiée à la Passion du Christ et qui occupait autrefois la baie axiale du chœur de l'église Saint-Martin. Les autres fragments sont conservés dans le transept nord.
Ce vitrail est la tête d'une lancette : le haut est décoratif. Dans un cadre jaune, est figuré l'intérieur d'un palais : le Christ est attaché à une colonne, et torturé par les bourreaux de Ponce Pilate. L'un le frappe avec un faisceau, l'autre avec un fouet à lanières. La scène s'inspirerait, comme les autres scènes de la verrière, d'une gravure de l'artiste allemand contemporain appelé « Maître E. S. ».
-
 Vitrail de sainte Ségolène (cathédrale de Metz)
Vitrail de sainte Ségolène (cathédrale de Metz) Ce vitrail (baie 4 de la cathédrale de Metz) a été sans doute offert par le chanoine Thiébaut Minet, par ailleurs curé de la paroisse Sainte-Ségolène. Très restauré, il est l'oeuvre du maître verrier Valentin Bousch, verrier du chapitre et de la cité de Metz dans la première moitié du XVIe siècle. Situé dans la chapelle Saint-Livier, une des chapelles du chœur, le vitrail représente le donateur à genoux à droite, dans un costume de chanoine ; à gauche, la sainte est représentée en abbesse enseignante, crosse en main et livre ouvert. Le cadre Renaissance est fait de pilastres et d'un entablement jaune d'argent et blanc.
-
 Vitrail des rois mages
Vitrail des rois mages Cette verrière d'une grande finesse provient de Sainte-Ségolène. Attribuée à Hermann de Münster, elle représente l'Adoration des Mages. Des trois lancettes, on a conservé les trois grands dais d'architecture gothique et deux des trois mages, figurés comme des rois couronnés allant présenter leurs cadeaux à Jésus qui vient de naître. Selon l'iconographie du XIVe siècle, les rois sont d'âges différents et non pas, comme au XVe siècle, de pays différents. Chacun porte un présent dans une boîte dorée ; le jeune tient un ciboire, sans doute rempli d'encens ; le roi âgé tient un coffret en forme de tour, peut-être rempli d'or. Il désigne du doigt un phylactère avec le texte latin : « Nous avons vu son étoile à l'Orient » (évangile selon saint Matthieu, 2, 2). Sous les pieds des rois, une inscription biblique en latin : « Les rois de Tarsis et des Iles [apporteront des présents]. Les rois de Saba et de Seba feront leur offrande ». Cette prophétie (Psaume 71, 10) annonce le règne universel du Christ, dont l'Adoration des rois est le signe.
Au-dessus des dais, deux écus sont identifiés comme ceux d'un patricien nommé Perrin Bouchatte (+1388), possible donateur de la verrière. La verrière a fait partie de la collection du peintre verrier messin Michel-Frédéric Thiria. À sa mort en 1938, elle a été acquise par le Musée lorrain de Nancy.
-
Vitraux de Génicourt-sur-Meuse
Après avoir reconstruit l'église jusqu'en 1524, les seigneurs de Génicourt liés aux paraiges commandent des vitraux à leurs effigies au verrier de la cathédrale de Metz, Valentin Bousch. Dans l’abside, cinq baies représentent la famille d’Apremont et ses alliés. Sur les murs Est des deux bas-côtés, une baie représente Nicole Remiat et sa femme Aimée d’Apremont (baie 5), l'autre leur fille Alixette Remiat et son mari Renaud Le Gronnais (baie 6).
-
 Vitraux de la Passion du Christ
Vitraux de la Passion du Christ Dans l'église Saint-Martin, huit vitraux représentent la Passion du Christ. Ils ont été insérés dans une baie du transept nord avec des ajouts décoratifs du XIXe siècle. Ils décoraient autrefois la baie axiale du choeur.
On reconnaît tout à gauche en bas le couronnement d'épines, puis en haut le portement de croix. Dans la deuxième lancette, en bas le Christ et sainte Véronique, puis en haut la Crucifixion. Dans la troisième lancette, en bas la descente de croix et en haut la mise au tombeau. Sur la lancette de droite, en bas la Résurrection et en haut le Jugement dernier.
Un neuvième fragment, la Flagellation, est conservé aujourd'hui conservé à Londres.
-
 Vitraux de la vie de la Vierge
Vitraux de la vie de la Vierge Cette série de vitraux de Saint-Martin peut être rapprochée de la fondation d'un autel dans cette église par Catherine Le Gronnais en 1467. La figure de donatrice peut représenter Catherine ; le donateur en armure peut être un de ses deux maris défunts, Jacques le Hungre ou Poince Baudoche.
-
 Vitraux de Sainte-Barbe : la Vierge et sainte Barbe
Vitraux de Sainte-Barbe : la Vierge et sainte Barbe Ces vitraux (baie 8 de la cathédrale) ont été créés par Valentin Bousch aux alentours de 1530 pour Claude Baudoche et son épouse Yolande de Croÿ. Ils se trouvaient à l’église Sainte-Barbe avant sa destruction en 1829. Acquis par le chapitre, ils ont été restaurés et remontés dans la cathédrale en 1842, dans la chapelle Saint-Livier, à droite derrière le chœur.
Sous de très grands dais d'architecture Renaissance, on voit à gauche la Vierge de l'Apocalypse : Marie, drapée de rayons de soleil et debout sur le croissant de lune, tient l'Enfant Jésus dans ses draps ; lui-même porte une croix dans ses mains. A droite, sainte Barbe, jeune fille blonde dans une grande robe rose, tient la palme, symbole du martyre, dans sa main droite.
-
 Vitraux de Sainte-Barbe : Philippe de Serrières et ses filles
Vitraux de Sainte-Barbe : Philippe de Serrières et ses filles Ces vitraux de la cathédrale Saint-Étienne (baie 7) ont été créés par Valentin Bousch pour Claude Baudoche et son épouse Yolande de Croÿ. Ils se trouvaient à l’église Sainte-Barbe avant sa destruction en 1829. Acquis par le chapitre, ils ont été restaurés et remontés dans la cathédrale en 1855, dans la chapelle Saint-Joseph, à gauche derrière le chœur.
Les personnages prennent place dans un grand édifice Renaissance blanc et or, richement décoré, orné de deux conques. À gauche, la femme à genoux devant son livre de prière est la première épouse de Claude Baudoche, Philippe de Serrières, décédée en 1504. Elle est présentée par son saint patron, l'apôtre Philippe, qui tient l'attribut de son martyre, la croix à double traverse. Derrière Philippe se tiennent ses deux filles, Claude et Bonne, l'une brune et l'autre blonde. Elles sont présentées par sainte Catherine, la sainte la plus populaire à la fin du Moyen Âge, reconnaissable à l'épée de son martyre.
-
 Vitraux de Sainte-Barbe : Pierre Baudoche et son fils Claude
Vitraux de Sainte-Barbe : Pierre Baudoche et son fils Claude Ces vitraux de la cathédrale (baie 6) ont été créés par Valentin Bousch pour Claude Baudoche et son épouse Yolande de Croÿ. Ils se trouvaient à l’église Sainte-Barbe avant sa destruction en 1829. Acquis par le chapitre, ils ont été restaurés et remontés dans la cathédrale en 1842, dans la chapelle Saint-Livier, à droite derrière le chœur.
Les personnages prennent place dans un grand édifice Renaissance blanc et or, richement décoré, orné d'une conque et d'un édicule à fronton. A gauche, sur un fond rouge intense, Claude Baudoche est à genoux devant son livre de prière. Il est présenté par son saint patron, l'évêque saint Claude, qui porte une croix épiscopale et une mitre. À droite, faisant face à Claude Baudoche, son père Pierre, mort en 1505, est lui aussi à genoux, mais habillé d'une armure de chevalier, l'épée au côté. Il est présenté par son patron, saint Pierre, qui porte une énorme clé.
-
 Vitraux de Sainte-Barbe : Yolande de Croÿ et ses fils
Vitraux de Sainte-Barbe : Yolande de Croÿ et ses fils Ces vitraux (baie 5 de la cathédrale) ont été créés par Valentin Bousch pour Claude Baudoche et son épouse Yolande de Croÿ. Ils se trouvaient à l’église Sainte-Barbe avant sa destruction en 1829. Acquis par le chapitre, ils ont été restaurés et remontés dans la cathédrale en 1855, dans la chapelle Saint-Joseph, à gauche derrière le chœur.
Les personnages prennent place dans un grand édifice Renaissance blanc et or, richement décoré, orné de deux conques. À droite, la femme à genoux devant son livre de prière est Yolande de Croÿ, épouse de Claude Baudoche et fondatrice avec lui de l'église Sainte-Barbe. Elle est est présentée par sa sainte patronne, sainte Yolande de Vianden, une princesse luxembourgeoise devenue religieuse dominicaine et morte en 1283. Sainte Yolande, dans son habit dominicain noir et blanc, porte la crosse de l'abbesse. Derrière Yolande de Croÿ, se pressent six jeunes gens, présentés par saint François d'Assise. Ce sont les fils de Yolande et de Claude : on connaît les noms de quatre d'entre eux, Robert, deux François et Jean. Le couple a pu avoir deux enfants morts en bas âge qui ont été représentés ici comme des jeunes hommes au milieu de leurs frères qui ont survécu. Saint François lève les bras au ciel : il contemple le Christ ressuscité, qui lui apparaît ailé comme un ange et lui fait partager les plaies de sa Passion : les stigmates.
-
Vitraux de Thomas de Clinchamp à l'église de Fèves
Thomas de Clinchamp, verrier de la cathédrale, est intervenu à Fèves. On conserve trois vitraux anciens, des baies à deux lancettes, restaurées en 1892. Pendant l'occupation, ces vitraux sont déposés et mis à l'abri dans la cave du presbytère de Fèves. Malheureusement, les caisses sont retrouvées défoncées et certains panneaux des vitraux sont piétinés. Ils sont restauré par l'atelier Gaudin à partir de 1947.
Les vitraux sont offerts à l'église de Fèves par Lambert Pierreson, chanoine de la cathédrale de Metz. Le vitrail de la baie axiale est signé « Hoc opus fecit Thomas » ce qui permet d'attribuer l'ouvrage à Thomas de Clinchamp, auteur de vitraux à Norroy-le-Veneur, à Magny et à la cathédrale de Metz.
La baie 0 (à deux lancettes et tympan) représente l’Annonciation sur fond de damas bleu et comporte l'inscription « VERBUM CARO FACTUM EST / HOC OPUS FECIT THOMAS ».
La baie 1 présente sur le tympan sont représentés des anges qui portent les tables de la loi et sur les lancettes, on retrouve saint Vincent, le donateur, Lambert Pierresson, avec son monogramme dans un écu, et un saint Martyr. Sous les personnages figure l'inscription en lettres gothiques « Messire Lambert Pierreson chanoine de l'abbaye de Fève ». Ce vitrail a été l'objet d'une lourde restauration.
La baie 2 montre sur le tympan des anges portant des calices et sur les lancettes, saint Nicolas ressuscitant trois enfants et sainte Odile libérant son père des flammes du purgatoire.
 Tympan aux dragons Ce tympan sculpté était situé rue de la Chèvre, au n°28, dans une maison donnant sur la cour, détruite dans les années 1970. Il en reste trois éléments sculptés au musée de la Cour d'Or : deux dragons et un personnage aux cheveux mi-longs, en tunique, qui a pu être identifiée avec sainte Constance. Une inscription fragmentaire a été relevée au XIXe siècle au-dessus : « wi.sart.iuet...? »
Tympan aux dragons Ce tympan sculpté était situé rue de la Chèvre, au n°28, dans une maison donnant sur la cour, détruite dans les années 1970. Il en reste trois éléments sculptés au musée de la Cour d'Or : deux dragons et un personnage aux cheveux mi-longs, en tunique, qui a pu être identifiée avec sainte Constance. Une inscription fragmentaire a été relevée au XIXe siècle au-dessus : « wi.sart.iuet...? »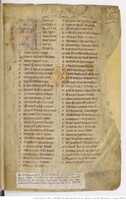 Vie des Pères, en vers (Paris, BNF, FR 20040) Incertaine
Vie des Pères, en vers (Paris, BNF, FR 20040) Incertaine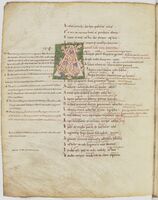 Virgile, Enéide (BnF, NAL, ms. 2059) Metz?
Virgile, Enéide (BnF, NAL, ms. 2059) Metz? Vitrail de Jean Bataille Ce vitrail commandé par Jean Bataille est attribué à l'atelier du verrier Hermann de Munster, qui travaille dans les années 1380 au chantier de la cathédrale. Le chevalier est vêtu comme un combattant de la fin du XIVe siècle : il porte une jaque, une veste matelassée et serrée, de couleur verte. La ceinture basse (demi-ceint) faite de plaques métalliques articulées, permet d'accrocher les gantelets de fer et l'épée. Sur la tête, le chevalier porte un bassinet dont la visière est relevée. Le cou et le bas du visage sont protégés par un camail en mailles. Le bas du corps est protégé par des cuissières et des jambières, reliées par des genouillères à ailerons. Les pieds sont chaussés de solerets à poulaine et à éperons. À genoux les mains jointes, Jean Bataille est en prière, l'inscription autour de sa tête invoque la Vierge, qui devait être figurée sur la partie droite du vitrail d'origine : « Memento queso mei Maria mater Dei Omnipotensis » (Souviens-toi de moi, je t'en prie, Marie mère du Dieu Tout-Puissant). Jean Bataille est identifiable à ses armes situées sur l'écu en-dessous de lui, porté par deux lions. Tous ces fragments ont été remployés ensemble au XIXe siècle pour former une baie sans cohérence (baie 9) dans l'absidiole nord de l'église Saint-Ségolène. Autour de lui, les donatrices, de différentes tailles et de différentes époques, ainsi que d'autres fragments, désignées seulement par leurs prénoms, ne sont pas identifiables.
Vitrail de Jean Bataille Ce vitrail commandé par Jean Bataille est attribué à l'atelier du verrier Hermann de Munster, qui travaille dans les années 1380 au chantier de la cathédrale. Le chevalier est vêtu comme un combattant de la fin du XIVe siècle : il porte une jaque, une veste matelassée et serrée, de couleur verte. La ceinture basse (demi-ceint) faite de plaques métalliques articulées, permet d'accrocher les gantelets de fer et l'épée. Sur la tête, le chevalier porte un bassinet dont la visière est relevée. Le cou et le bas du visage sont protégés par un camail en mailles. Le bas du corps est protégé par des cuissières et des jambières, reliées par des genouillères à ailerons. Les pieds sont chaussés de solerets à poulaine et à éperons. À genoux les mains jointes, Jean Bataille est en prière, l'inscription autour de sa tête invoque la Vierge, qui devait être figurée sur la partie droite du vitrail d'origine : « Memento queso mei Maria mater Dei Omnipotensis » (Souviens-toi de moi, je t'en prie, Marie mère du Dieu Tout-Puissant). Jean Bataille est identifiable à ses armes situées sur l'écu en-dessous de lui, porté par deux lions. Tous ces fragments ont été remployés ensemble au XIXe siècle pour former une baie sans cohérence (baie 9) dans l'absidiole nord de l'église Saint-Ségolène. Autour de lui, les donatrices, de différentes tailles et de différentes époques, ainsi que d'autres fragments, désignées seulement par leurs prénoms, ne sont pas identifiables. Vitrail de la Flagellation du Christ Ce vitrail aujourd'hui conservé à Londres provient d'une verrière dédiée à la Passion du Christ et qui occupait autrefois la baie axiale du chœur de l'église Saint-Martin. Les autres fragments sont conservés dans le transept nord. Ce vitrail est la tête d'une lancette : le haut est décoratif. Dans un cadre jaune, est figuré l'intérieur d'un palais : le Christ est attaché à une colonne, et torturé par les bourreaux de Ponce Pilate. L'un le frappe avec un faisceau, l'autre avec un fouet à lanières. La scène s'inspirerait, comme les autres scènes de la verrière, d'une gravure de l'artiste allemand contemporain appelé « Maître E. S. ».
Vitrail de la Flagellation du Christ Ce vitrail aujourd'hui conservé à Londres provient d'une verrière dédiée à la Passion du Christ et qui occupait autrefois la baie axiale du chœur de l'église Saint-Martin. Les autres fragments sont conservés dans le transept nord. Ce vitrail est la tête d'une lancette : le haut est décoratif. Dans un cadre jaune, est figuré l'intérieur d'un palais : le Christ est attaché à une colonne, et torturé par les bourreaux de Ponce Pilate. L'un le frappe avec un faisceau, l'autre avec un fouet à lanières. La scène s'inspirerait, comme les autres scènes de la verrière, d'une gravure de l'artiste allemand contemporain appelé « Maître E. S. ». Vitrail de sainte Ségolène (cathédrale de Metz) Ce vitrail (baie 4 de la cathédrale de Metz) a été sans doute offert par le chanoine Thiébaut Minet, par ailleurs curé de la paroisse Sainte-Ségolène. Très restauré, il est l'oeuvre du maître verrier Valentin Bousch, verrier du chapitre et de la cité de Metz dans la première moitié du XVIe siècle. Situé dans la chapelle Saint-Livier, une des chapelles du chœur, le vitrail représente le donateur à genoux à droite, dans un costume de chanoine ; à gauche, la sainte est représentée en abbesse enseignante, crosse en main et livre ouvert. Le cadre Renaissance est fait de pilastres et d'un entablement jaune d'argent et blanc.
Vitrail de sainte Ségolène (cathédrale de Metz) Ce vitrail (baie 4 de la cathédrale de Metz) a été sans doute offert par le chanoine Thiébaut Minet, par ailleurs curé de la paroisse Sainte-Ségolène. Très restauré, il est l'oeuvre du maître verrier Valentin Bousch, verrier du chapitre et de la cité de Metz dans la première moitié du XVIe siècle. Situé dans la chapelle Saint-Livier, une des chapelles du chœur, le vitrail représente le donateur à genoux à droite, dans un costume de chanoine ; à gauche, la sainte est représentée en abbesse enseignante, crosse en main et livre ouvert. Le cadre Renaissance est fait de pilastres et d'un entablement jaune d'argent et blanc. Vitrail des rois mages Cette verrière d'une grande finesse provient de Sainte-Ségolène. Attribuée à Hermann de Münster, elle représente l'Adoration des Mages. Des trois lancettes, on a conservé les trois grands dais d'architecture gothique et deux des trois mages, figurés comme des rois couronnés allant présenter leurs cadeaux à Jésus qui vient de naître. Selon l'iconographie du XIVe siècle, les rois sont d'âges différents et non pas, comme au XVe siècle, de pays différents. Chacun porte un présent dans une boîte dorée ; le jeune tient un ciboire, sans doute rempli d'encens ; le roi âgé tient un coffret en forme de tour, peut-être rempli d'or. Il désigne du doigt un phylactère avec le texte latin : « Nous avons vu son étoile à l'Orient » (évangile selon saint Matthieu, 2, 2). Sous les pieds des rois, une inscription biblique en latin : « Les rois de Tarsis et des Iles [apporteront des présents]. Les rois de Saba et de Seba feront leur offrande ». Cette prophétie (Psaume 71, 10) annonce le règne universel du Christ, dont l'Adoration des rois est le signe. Au-dessus des dais, deux écus sont identifiés comme ceux d'un patricien nommé Perrin Bouchatte (+1388), possible donateur de la verrière. La verrière a fait partie de la collection du peintre verrier messin Michel-Frédéric Thiria. À sa mort en 1938, elle a été acquise par le Musée lorrain de Nancy.
Vitrail des rois mages Cette verrière d'une grande finesse provient de Sainte-Ségolène. Attribuée à Hermann de Münster, elle représente l'Adoration des Mages. Des trois lancettes, on a conservé les trois grands dais d'architecture gothique et deux des trois mages, figurés comme des rois couronnés allant présenter leurs cadeaux à Jésus qui vient de naître. Selon l'iconographie du XIVe siècle, les rois sont d'âges différents et non pas, comme au XVe siècle, de pays différents. Chacun porte un présent dans une boîte dorée ; le jeune tient un ciboire, sans doute rempli d'encens ; le roi âgé tient un coffret en forme de tour, peut-être rempli d'or. Il désigne du doigt un phylactère avec le texte latin : « Nous avons vu son étoile à l'Orient » (évangile selon saint Matthieu, 2, 2). Sous les pieds des rois, une inscription biblique en latin : « Les rois de Tarsis et des Iles [apporteront des présents]. Les rois de Saba et de Seba feront leur offrande ». Cette prophétie (Psaume 71, 10) annonce le règne universel du Christ, dont l'Adoration des rois est le signe. Au-dessus des dais, deux écus sont identifiés comme ceux d'un patricien nommé Perrin Bouchatte (+1388), possible donateur de la verrière. La verrière a fait partie de la collection du peintre verrier messin Michel-Frédéric Thiria. À sa mort en 1938, elle a été acquise par le Musée lorrain de Nancy. Vitraux de la Passion du Christ Dans l'église Saint-Martin, huit vitraux représentent la Passion du Christ. Ils ont été insérés dans une baie du transept nord avec des ajouts décoratifs du XIXe siècle. Ils décoraient autrefois la baie axiale du choeur. On reconnaît tout à gauche en bas le couronnement d'épines, puis en haut le portement de croix. Dans la deuxième lancette, en bas le Christ et sainte Véronique, puis en haut la Crucifixion. Dans la troisième lancette, en bas la descente de croix et en haut la mise au tombeau. Sur la lancette de droite, en bas la Résurrection et en haut le Jugement dernier. Un neuvième fragment, la Flagellation, est conservé aujourd'hui conservé à Londres.
Vitraux de la Passion du Christ Dans l'église Saint-Martin, huit vitraux représentent la Passion du Christ. Ils ont été insérés dans une baie du transept nord avec des ajouts décoratifs du XIXe siècle. Ils décoraient autrefois la baie axiale du choeur. On reconnaît tout à gauche en bas le couronnement d'épines, puis en haut le portement de croix. Dans la deuxième lancette, en bas le Christ et sainte Véronique, puis en haut la Crucifixion. Dans la troisième lancette, en bas la descente de croix et en haut la mise au tombeau. Sur la lancette de droite, en bas la Résurrection et en haut le Jugement dernier. Un neuvième fragment, la Flagellation, est conservé aujourd'hui conservé à Londres. Vitraux de la vie de la Vierge Cette série de vitraux de Saint-Martin peut être rapprochée de la fondation d'un autel dans cette église par Catherine Le Gronnais en 1467. La figure de donatrice peut représenter Catherine ; le donateur en armure peut être un de ses deux maris défunts, Jacques le Hungre ou Poince Baudoche.
Vitraux de la vie de la Vierge Cette série de vitraux de Saint-Martin peut être rapprochée de la fondation d'un autel dans cette église par Catherine Le Gronnais en 1467. La figure de donatrice peut représenter Catherine ; le donateur en armure peut être un de ses deux maris défunts, Jacques le Hungre ou Poince Baudoche. Vitraux de Sainte-Barbe : la Vierge et sainte Barbe Ces vitraux (baie 8 de la cathédrale) ont été créés par Valentin Bousch aux alentours de 1530 pour Claude Baudoche et son épouse Yolande de Croÿ. Ils se trouvaient à l’église Sainte-Barbe avant sa destruction en 1829. Acquis par le chapitre, ils ont été restaurés et remontés dans la cathédrale en 1842, dans la chapelle Saint-Livier, à droite derrière le chœur. Sous de très grands dais d'architecture Renaissance, on voit à gauche la Vierge de l'Apocalypse : Marie, drapée de rayons de soleil et debout sur le croissant de lune, tient l'Enfant Jésus dans ses draps ; lui-même porte une croix dans ses mains. A droite, sainte Barbe, jeune fille blonde dans une grande robe rose, tient la palme, symbole du martyre, dans sa main droite.
Vitraux de Sainte-Barbe : la Vierge et sainte Barbe Ces vitraux (baie 8 de la cathédrale) ont été créés par Valentin Bousch aux alentours de 1530 pour Claude Baudoche et son épouse Yolande de Croÿ. Ils se trouvaient à l’église Sainte-Barbe avant sa destruction en 1829. Acquis par le chapitre, ils ont été restaurés et remontés dans la cathédrale en 1842, dans la chapelle Saint-Livier, à droite derrière le chœur. Sous de très grands dais d'architecture Renaissance, on voit à gauche la Vierge de l'Apocalypse : Marie, drapée de rayons de soleil et debout sur le croissant de lune, tient l'Enfant Jésus dans ses draps ; lui-même porte une croix dans ses mains. A droite, sainte Barbe, jeune fille blonde dans une grande robe rose, tient la palme, symbole du martyre, dans sa main droite. Vitraux de Sainte-Barbe : Philippe de Serrières et ses filles Ces vitraux de la cathédrale Saint-Étienne (baie 7) ont été créés par Valentin Bousch pour Claude Baudoche et son épouse Yolande de Croÿ. Ils se trouvaient à l’église Sainte-Barbe avant sa destruction en 1829. Acquis par le chapitre, ils ont été restaurés et remontés dans la cathédrale en 1855, dans la chapelle Saint-Joseph, à gauche derrière le chœur. Les personnages prennent place dans un grand édifice Renaissance blanc et or, richement décoré, orné de deux conques. À gauche, la femme à genoux devant son livre de prière est la première épouse de Claude Baudoche, Philippe de Serrières, décédée en 1504. Elle est présentée par son saint patron, l'apôtre Philippe, qui tient l'attribut de son martyre, la croix à double traverse. Derrière Philippe se tiennent ses deux filles, Claude et Bonne, l'une brune et l'autre blonde. Elles sont présentées par sainte Catherine, la sainte la plus populaire à la fin du Moyen Âge, reconnaissable à l'épée de son martyre.
Vitraux de Sainte-Barbe : Philippe de Serrières et ses filles Ces vitraux de la cathédrale Saint-Étienne (baie 7) ont été créés par Valentin Bousch pour Claude Baudoche et son épouse Yolande de Croÿ. Ils se trouvaient à l’église Sainte-Barbe avant sa destruction en 1829. Acquis par le chapitre, ils ont été restaurés et remontés dans la cathédrale en 1855, dans la chapelle Saint-Joseph, à gauche derrière le chœur. Les personnages prennent place dans un grand édifice Renaissance blanc et or, richement décoré, orné de deux conques. À gauche, la femme à genoux devant son livre de prière est la première épouse de Claude Baudoche, Philippe de Serrières, décédée en 1504. Elle est présentée par son saint patron, l'apôtre Philippe, qui tient l'attribut de son martyre, la croix à double traverse. Derrière Philippe se tiennent ses deux filles, Claude et Bonne, l'une brune et l'autre blonde. Elles sont présentées par sainte Catherine, la sainte la plus populaire à la fin du Moyen Âge, reconnaissable à l'épée de son martyre. Vitraux de Sainte-Barbe : Pierre Baudoche et son fils Claude Ces vitraux de la cathédrale (baie 6) ont été créés par Valentin Bousch pour Claude Baudoche et son épouse Yolande de Croÿ. Ils se trouvaient à l’église Sainte-Barbe avant sa destruction en 1829. Acquis par le chapitre, ils ont été restaurés et remontés dans la cathédrale en 1842, dans la chapelle Saint-Livier, à droite derrière le chœur. Les personnages prennent place dans un grand édifice Renaissance blanc et or, richement décoré, orné d'une conque et d'un édicule à fronton. A gauche, sur un fond rouge intense, Claude Baudoche est à genoux devant son livre de prière. Il est présenté par son saint patron, l'évêque saint Claude, qui porte une croix épiscopale et une mitre. À droite, faisant face à Claude Baudoche, son père Pierre, mort en 1505, est lui aussi à genoux, mais habillé d'une armure de chevalier, l'épée au côté. Il est présenté par son patron, saint Pierre, qui porte une énorme clé.
Vitraux de Sainte-Barbe : Pierre Baudoche et son fils Claude Ces vitraux de la cathédrale (baie 6) ont été créés par Valentin Bousch pour Claude Baudoche et son épouse Yolande de Croÿ. Ils se trouvaient à l’église Sainte-Barbe avant sa destruction en 1829. Acquis par le chapitre, ils ont été restaurés et remontés dans la cathédrale en 1842, dans la chapelle Saint-Livier, à droite derrière le chœur. Les personnages prennent place dans un grand édifice Renaissance blanc et or, richement décoré, orné d'une conque et d'un édicule à fronton. A gauche, sur un fond rouge intense, Claude Baudoche est à genoux devant son livre de prière. Il est présenté par son saint patron, l'évêque saint Claude, qui porte une croix épiscopale et une mitre. À droite, faisant face à Claude Baudoche, son père Pierre, mort en 1505, est lui aussi à genoux, mais habillé d'une armure de chevalier, l'épée au côté. Il est présenté par son patron, saint Pierre, qui porte une énorme clé. Vitraux de Sainte-Barbe : Yolande de Croÿ et ses fils Ces vitraux (baie 5 de la cathédrale) ont été créés par Valentin Bousch pour Claude Baudoche et son épouse Yolande de Croÿ. Ils se trouvaient à l’église Sainte-Barbe avant sa destruction en 1829. Acquis par le chapitre, ils ont été restaurés et remontés dans la cathédrale en 1855, dans la chapelle Saint-Joseph, à gauche derrière le chœur. Les personnages prennent place dans un grand édifice Renaissance blanc et or, richement décoré, orné de deux conques. À droite, la femme à genoux devant son livre de prière est Yolande de Croÿ, épouse de Claude Baudoche et fondatrice avec lui de l'église Sainte-Barbe. Elle est est présentée par sa sainte patronne, sainte Yolande de Vianden, une princesse luxembourgeoise devenue religieuse dominicaine et morte en 1283. Sainte Yolande, dans son habit dominicain noir et blanc, porte la crosse de l'abbesse. Derrière Yolande de Croÿ, se pressent six jeunes gens, présentés par saint François d'Assise. Ce sont les fils de Yolande et de Claude : on connaît les noms de quatre d'entre eux, Robert, deux François et Jean. Le couple a pu avoir deux enfants morts en bas âge qui ont été représentés ici comme des jeunes hommes au milieu de leurs frères qui ont survécu. Saint François lève les bras au ciel : il contemple le Christ ressuscité, qui lui apparaît ailé comme un ange et lui fait partager les plaies de sa Passion : les stigmates.
Vitraux de Sainte-Barbe : Yolande de Croÿ et ses fils Ces vitraux (baie 5 de la cathédrale) ont été créés par Valentin Bousch pour Claude Baudoche et son épouse Yolande de Croÿ. Ils se trouvaient à l’église Sainte-Barbe avant sa destruction en 1829. Acquis par le chapitre, ils ont été restaurés et remontés dans la cathédrale en 1855, dans la chapelle Saint-Joseph, à gauche derrière le chœur. Les personnages prennent place dans un grand édifice Renaissance blanc et or, richement décoré, orné de deux conques. À droite, la femme à genoux devant son livre de prière est Yolande de Croÿ, épouse de Claude Baudoche et fondatrice avec lui de l'église Sainte-Barbe. Elle est est présentée par sa sainte patronne, sainte Yolande de Vianden, une princesse luxembourgeoise devenue religieuse dominicaine et morte en 1283. Sainte Yolande, dans son habit dominicain noir et blanc, porte la crosse de l'abbesse. Derrière Yolande de Croÿ, se pressent six jeunes gens, présentés par saint François d'Assise. Ce sont les fils de Yolande et de Claude : on connaît les noms de quatre d'entre eux, Robert, deux François et Jean. Le couple a pu avoir deux enfants morts en bas âge qui ont été représentés ici comme des jeunes hommes au milieu de leurs frères qui ont survécu. Saint François lève les bras au ciel : il contemple le Christ ressuscité, qui lui apparaît ailé comme un ange et lui fait partager les plaies de sa Passion : les stigmates.