-
 Fragment de carreau de pavement de Saint-Nicolas
Fragment de carreau de pavement de Saint-Nicolas Ce carreau de pavement est carré à décor géométrique (motif de losange) et provient des fouilles de l'hôpital Saint-Nicolas. Sa technique, la céramique glaçurée, illustre le luxe de l'établissement d'accueil.
-
Foulques Bertrand (13..-1377)
Foulques Bertrand est chanoine de la cathédrale à partir de 1351. Il est sans doute apparenté à son homonyme qui a occupé avant lui la dignité de primicier, et d'une demi-douzaine d'autres Bertrand chanoines au XIVe siècle. Foulques accède à la dignité de coûtre en 1368. Il occupe la maison canoniale n°39, jusqu'à son décès en 1377. Il est enterré dans la cathédrale. Son épitaphe, fragmentaire, a été mal lue par Sébastien Dieudonné ; Wilhelm Schmitz et Gonzalve Thiriot la rendent à Foulques Bertrand.
-
Foulques Bertrand (13..-135.)
Au moins huit membres de la famille Bertrand ont été chanoines de la cathédrale au cours du XIVe siècle, dont trois fils de Jean Bertrand : Nicole, Pierre et Foulques, ou Fourques. Foulques Bertrand occupe la dignité de primicier entre 1336 et 1344. Il habite la Princerie. Il fut opposé à Charles de Poitiers dans un procès pour la dignité de princier, qui ne cessa qu'à sa mort.
Un autre Foulques Bertrand est chanoine en 1351, coûtre en 1368 et décède en 1377. Il s'agit sans doute d'un homonyme et d'un parent.
-
Forquignon Noiron (13..-13..)
Forquignon Noiron est le fils de Nemmery Noiron et de Maiausette Brady. Son épouse est inconnue, mais son fils Nemmery Noiron dit Guedange nous est connu. Vers 1380, il est convié, en compagnie de deux autres treize jurés : Jean Roucel et Nicolle Mortel, à résoudre une transaction entre les deux chapitres de la cathédrale de Metz et de l'église Notre-Dame-la-Ronde concernant un mur qui coupait en travers la nef de la Cathédrale. Il meurt le 8 avril 1393. Il est enseveli dans l'église Sainte-Croix, là où il possédait une charge d'amandellerie.
-
Fonts baptismaux de Vigneulles
Les fonts baptismaux sont contemporains de la construction de l'église de Vigneulles, due au patronage de Jean Gérard, maire du village et père de Philippe de Vigneulles. Ils ont pu être déposés dans l'église de Lorry après la Révolution.
La partie supérieure, haute de 22 cm, est moderne. La plinthe, haute de 22,5 cm, est plate. Au-dessus, le fût de 37 cm de haut est orné sur chacune de ses huit faces d'une niche en ogive. Au-dessus, le chapiteau de 19 à 24 cm de haut porte une inscription gravée sur cinq des faces. Déclarée illisible par Ernest Bouteiller au XIXe siècle, elle a été déchiffrée par Roch-Stéphane Bour en 1915 : « Priez pour Jean Gérard qui a donné la pierre et la façon, Priez pour celui qui a donné le bassin ».
-
Fontaine Saint-Aultre
Cette source miraculeuse était située au Moyen Âge dans le cimetière de l'église Saint-Simplice, tout près de la Seille. Elle est liée à la légende de saint Aultre (ou saint Auctor), pauvre savetier devenu évêque de Metz au temps de la destruction de Metz par les Barbares. La Chronique française des évêques de Metz raconte ainsi la légende : alors que l'évêque de Metz a été tué par les Barbares, un homme a la révélation que Dieu désire un certain Auctor pour évêque. On le trouve en train de fabriquer des chaussures derrière l'église Saint-Simplice : c'est un artisan illettré. Il refuse la charge, en disant qu'il ne croira être choisi que si son alêne (poinçon de cordonnier) fait jaillir une source... ce qui arrive. Aultre devient le 13e évêque de Metz, pendant 49 ans.
Jusqu'au XVIIIe siècle, la fontaine est fréquentée par les mères pour y guérir leurs enfants malingres.
À la fin du XIXe siècle, la source est oubliée : l'abbé Poirier fait creuser le site et découvre un bassin encore rempli d'eau derrière la cave à pommes de terres du concierge de l'école Saint-Simplice. Le site a peut-être été aujourd'hui détruit.
-
Flory de Marteau (15..-15..)
Flory de Marteau est un noble possiblement originaire du Dauphiné, fils de Roch de Marteau. Il se marie en premières noces à Barbe, fille de Renaud Desch et de Barbe de Montarby. C'est une double alliance entre les deux familles : Roch de Marteau après son remariage avec Barbe de Montarby fait marier les enfants du premier lit : Barbe et Flory. Barbe meurt le laissant veuf avant 1561. Flory se remarie avec sa cousine germaine, Anne Desch et meurt avant 1586.
-
 Florilège de textes latins de Nicolle Desch (Paris, BNF, LAT 1616)
Florilège de textes latins de Nicolle Desch (Paris, BNF, LAT 1616) Inconnue
-
Ferraresso, Ivan, La maison en Lorraine, du Moyen Âge à la Renaissance
Ferraresso, Ivan, La maison en Lorraine, du Moyen Âge à la Renaissance (XIIIe-XVIe siècles), thèse de doctorat inédite, Université de Lorraine, Nancy, 2015.
-
 Ferme-château Saint-Nicolas de Fleury
Ferme-château Saint-Nicolas de Fleury L'hôpital Saint-Nicolas était propriétaire d'un vaste patrimoine rural autour de Metz, qui lui assurait des revenus réguliers. Il était seigneur d'un des deux bans du village de Fleury, et y possédait un gagnage, reconstruit au XVIe siècle. L'exploitation était assurée par des convers, sous la direction d'un maître. Le domaine est resté propriété hospitalière jusqu'en 1957.
Les bâtiments agricoles formaient un quadrilatère de 90 à 100 m. de côté autour d'une cour ; il en reste plusieurs, reconvertis en habitation, et surtout la tour, à la fois porche et logis principal. Cette tour de plan carré à deux étages est construite en pierre de Jaumont. Le porche s'ouvre au rez-de-chaussée ; par un escalier situé dans une tourelle d'angle ronde, on accède au premier étage où se trouve la grande salle et sa cheminée monumentale.
En 1869, Charles Abel mentionne des décors et des maximes peints au XVIe siècle sur les murs de la grande salle, et la présence d'une Vierge à l'Enfant médiévale dans une niche : il s'agit vraisemblablement de la statue vénérée sous le nom de "Notre-Dame-de-la-Ferme", ensuite déplacée à l'hôpital Bon-Secours de Metz, actuellement à l'hôpital Mercy.
-
 Ferme Saint-Ladre
Ferme Saint-Ladre Cette exploitation agricole dépendait de l'hôpital Saint-Nicolas, le principal hôpital de Metz. Saint-Nicolas gérait d'autres établissements de soin et d'accueil, comme les léproseries de Saint-Ladre à Montigny, et des fermes qui assuraient une partie du budget de l'hôpital. La ferme Saint-Ladre a été détruite en 1984.
-
Ferber, Frédéric, « Les étuves »
Ferber, Frédéric, « Les étuves », dans Julien Trapp (dir.), Metz à la fin du Moyen Âge (fin XIVe - milieu XVIe siècle), Milan, Éditions Silvana, 2024, p. 151-160
-
Ferber, Frédéric, « La digue de Wadrineau, pièce maîtresse du réseau hydraulique messin »
Ferber, Frédéric, « La digue de Wadrineau, pièce maîtresse du réseau hydraulique messin », dans Julien Trapp (dir.), Metz à la fin du Moyen Âge (fin XIVe - milieu XVIe siècle), Milan, Éditions Silvana, 2024, p. 237-240
-
Ferber, Frédéric, « Composition urbaine et cours d’eau : Metz et la Moselle au Moyen Âge »
Ferber, Frédéric, « Composition urbaine et cours d’eau : Metz et la Moselle au Moyen Âge », dans Composition urbaine et réseaux, Paris, CTHS, 2014, p. 66-77.
-
Favier, Justin, éd., « La bibliothèque d'un maître-échevin de Metz [Michel Chaverson] au commencement du XVIe siècle »
Favier, Justin, éd., « La bibliothèque d'un maître-échevin de Metz [Michel Chaverson] au commencement du XVIe siècle », Paris, Frères Sidot, 1885.
-
 Fausse-braie et moineau de Philippe Desch
Fausse-braie et moineau de Philippe Desch En 1526-1527, le Sept des Murs Philippe Desch entreprend des travaux de modernisation des fortifications de Metz au nord de la porte des Allemands. Sur 248 m est construite une fausse-braie, c'est-à-dire un second mur devant l'enceinte, lui-même protégé par un terrassement à sa base. Un moineau, ouvrage bas donnant sur les fossés, permet des tirs de flanquement.
Une frise a été sculptée à la base du mur, en partie remblayée depuis le début du XXe siècle. Elle est connue par un relevé de 1856 et un sondage archéologique de 2013.
Philippe Desch a donné un décor exceptionnel à cette partie des murs : on a sculpté des boulets, des scènes figurées et des portraits, réalistes ou caricaturaux. Sur le moineau, un personnage entouré par les guimbardes emblématiques des Desch montre ses fesses aux ennemis de la cité. Sur le moineau et la frise de la fausse-braie, Philippe s'est fait représenter avec ses collaborateurs, identifiés par une inscription à l'intérieur du moineau : le clerc Pieron Peltre, le maçon maître d'oeuvre Thiedrich et le sergent du chantier Falquenel.
L'intérieur du moineau n'est pas accessible.
-
Faultrier, Gaston de, « Luttange »
Faultrier, Gaston de, « Luttange », Bulletin de la Société d'archéologie et d'histoire de la Moselle, 1864, p. 111-118.
-
 Fauconneau Desch
Fauconneau Desch Ce canon de bronze à fût octogonal, autrefois monté sur un affut à deux roues, est appelé fauconneau. Il s'agit d'une pièce d'apparat commandée par la famille Desch, qui y a fait sculpter ses armes et sa devise, la guimbarde. Le canon est daté et signé Maître Denis, qui peut identifier le fondeur mais aussi un possesseur ultérieur. La décoration de cette arme est très riche : les anses sont en forme de dragons, la culasse porte une harpie sculptée, les côtés de l'octogone sont ornés de décors architecturaux, de feuillages et de personnages masculins et féminins. Ce canon provient peut-être de Flandre, ou plus sûrement d'Allemagne du Sud, où des ateliers spécialisés produisent de tels objets de luxe à cette époque.
-
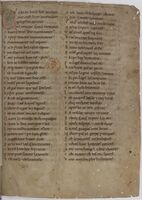 Evrat, La Genèse en vers (Paris, BNF, FR 12456)
Evrat, La Genèse en vers (Paris, BNF, FR 12456) Metz (Moselle) ou Verdun (Meuse)
-
 Evrard Marlier (14..-1525)
Evrard Marlier (14..-1525) Evrard Marlier est le neveu du doyen du chapitre de la cathédrale Otton Savin. En 1470, il est son exécuteur testamentaire. Lui-même n'obtient qu'une demi-prébende de la cathédrale. Il meurt en 1525, faisant réaliser par son propre testament des legs promis par son oncle 55 ans auparavant, dont une verrière offerte à la cathédrale et réalisée par Valentin Bousch.
-
Evrard Haze (13..-1418)
Evrard Haze est peut-être issu de la famille lorraine des Haze von Dieblich, au service des ducs de Lorraine. Il est chanoine de la cathédrale de Metz et aumônier du chapitre entre 1412 et 1415. Il est ensuite primicier et meurt en 1418.
-
Evrard de Trémaugon, Le songe du verger (Nancy, BS, inc. 120)
Lyon (Rhône)
-
Évêque
L'évêque est le prélat élu pour prendre la direction d'un diocèse de l'Eglise catholique. Il ordonne les nouveaux prêtres et consacre les autels des églises. À l'époque médiévale, l'évêque dispose également d'un pouvoir temporel : il administre "l'évêché", une seigneurie appartenant à son diocèse. L'évêque suffragant s'occupe donc des affaires spirituelles, secondant l'évêque qui se consacre davantage au gouvernement temporel.
-
Évangiles précédés des postilles de Nicolas de Lyre (Metz, BM, ms. 156)
-
Évangiles et épitres, de Jacques III Desch (Paris, BNF, Arsenal ms. 2083)
 Fragment de carreau de pavement de Saint-Nicolas Ce carreau de pavement est carré à décor géométrique (motif de losange) et provient des fouilles de l'hôpital Saint-Nicolas. Sa technique, la céramique glaçurée, illustre le luxe de l'établissement d'accueil.
Fragment de carreau de pavement de Saint-Nicolas Ce carreau de pavement est carré à décor géométrique (motif de losange) et provient des fouilles de l'hôpital Saint-Nicolas. Sa technique, la céramique glaçurée, illustre le luxe de l'établissement d'accueil. Florilège de textes latins de Nicolle Desch (Paris, BNF, LAT 1616) Inconnue
Florilège de textes latins de Nicolle Desch (Paris, BNF, LAT 1616) Inconnue Ferme-château Saint-Nicolas de Fleury L'hôpital Saint-Nicolas était propriétaire d'un vaste patrimoine rural autour de Metz, qui lui assurait des revenus réguliers. Il était seigneur d'un des deux bans du village de Fleury, et y possédait un gagnage, reconstruit au XVIe siècle. L'exploitation était assurée par des convers, sous la direction d'un maître. Le domaine est resté propriété hospitalière jusqu'en 1957. Les bâtiments agricoles formaient un quadrilatère de 90 à 100 m. de côté autour d'une cour ; il en reste plusieurs, reconvertis en habitation, et surtout la tour, à la fois porche et logis principal. Cette tour de plan carré à deux étages est construite en pierre de Jaumont. Le porche s'ouvre au rez-de-chaussée ; par un escalier situé dans une tourelle d'angle ronde, on accède au premier étage où se trouve la grande salle et sa cheminée monumentale. En 1869, Charles Abel mentionne des décors et des maximes peints au XVIe siècle sur les murs de la grande salle, et la présence d'une Vierge à l'Enfant médiévale dans une niche : il s'agit vraisemblablement de la statue vénérée sous le nom de "Notre-Dame-de-la-Ferme", ensuite déplacée à l'hôpital Bon-Secours de Metz, actuellement à l'hôpital Mercy.
Ferme-château Saint-Nicolas de Fleury L'hôpital Saint-Nicolas était propriétaire d'un vaste patrimoine rural autour de Metz, qui lui assurait des revenus réguliers. Il était seigneur d'un des deux bans du village de Fleury, et y possédait un gagnage, reconstruit au XVIe siècle. L'exploitation était assurée par des convers, sous la direction d'un maître. Le domaine est resté propriété hospitalière jusqu'en 1957. Les bâtiments agricoles formaient un quadrilatère de 90 à 100 m. de côté autour d'une cour ; il en reste plusieurs, reconvertis en habitation, et surtout la tour, à la fois porche et logis principal. Cette tour de plan carré à deux étages est construite en pierre de Jaumont. Le porche s'ouvre au rez-de-chaussée ; par un escalier situé dans une tourelle d'angle ronde, on accède au premier étage où se trouve la grande salle et sa cheminée monumentale. En 1869, Charles Abel mentionne des décors et des maximes peints au XVIe siècle sur les murs de la grande salle, et la présence d'une Vierge à l'Enfant médiévale dans une niche : il s'agit vraisemblablement de la statue vénérée sous le nom de "Notre-Dame-de-la-Ferme", ensuite déplacée à l'hôpital Bon-Secours de Metz, actuellement à l'hôpital Mercy. Ferme Saint-Ladre Cette exploitation agricole dépendait de l'hôpital Saint-Nicolas, le principal hôpital de Metz. Saint-Nicolas gérait d'autres établissements de soin et d'accueil, comme les léproseries de Saint-Ladre à Montigny, et des fermes qui assuraient une partie du budget de l'hôpital. La ferme Saint-Ladre a été détruite en 1984.
Ferme Saint-Ladre Cette exploitation agricole dépendait de l'hôpital Saint-Nicolas, le principal hôpital de Metz. Saint-Nicolas gérait d'autres établissements de soin et d'accueil, comme les léproseries de Saint-Ladre à Montigny, et des fermes qui assuraient une partie du budget de l'hôpital. La ferme Saint-Ladre a été détruite en 1984. Fausse-braie et moineau de Philippe Desch En 1526-1527, le Sept des Murs Philippe Desch entreprend des travaux de modernisation des fortifications de Metz au nord de la porte des Allemands. Sur 248 m est construite une fausse-braie, c'est-à-dire un second mur devant l'enceinte, lui-même protégé par un terrassement à sa base. Un moineau, ouvrage bas donnant sur les fossés, permet des tirs de flanquement. Une frise a été sculptée à la base du mur, en partie remblayée depuis le début du XXe siècle. Elle est connue par un relevé de 1856 et un sondage archéologique de 2013. Philippe Desch a donné un décor exceptionnel à cette partie des murs : on a sculpté des boulets, des scènes figurées et des portraits, réalistes ou caricaturaux. Sur le moineau, un personnage entouré par les guimbardes emblématiques des Desch montre ses fesses aux ennemis de la cité. Sur le moineau et la frise de la fausse-braie, Philippe s'est fait représenter avec ses collaborateurs, identifiés par une inscription à l'intérieur du moineau : le clerc Pieron Peltre, le maçon maître d'oeuvre Thiedrich et le sergent du chantier Falquenel. L'intérieur du moineau n'est pas accessible.
Fausse-braie et moineau de Philippe Desch En 1526-1527, le Sept des Murs Philippe Desch entreprend des travaux de modernisation des fortifications de Metz au nord de la porte des Allemands. Sur 248 m est construite une fausse-braie, c'est-à-dire un second mur devant l'enceinte, lui-même protégé par un terrassement à sa base. Un moineau, ouvrage bas donnant sur les fossés, permet des tirs de flanquement. Une frise a été sculptée à la base du mur, en partie remblayée depuis le début du XXe siècle. Elle est connue par un relevé de 1856 et un sondage archéologique de 2013. Philippe Desch a donné un décor exceptionnel à cette partie des murs : on a sculpté des boulets, des scènes figurées et des portraits, réalistes ou caricaturaux. Sur le moineau, un personnage entouré par les guimbardes emblématiques des Desch montre ses fesses aux ennemis de la cité. Sur le moineau et la frise de la fausse-braie, Philippe s'est fait représenter avec ses collaborateurs, identifiés par une inscription à l'intérieur du moineau : le clerc Pieron Peltre, le maçon maître d'oeuvre Thiedrich et le sergent du chantier Falquenel. L'intérieur du moineau n'est pas accessible. Fauconneau Desch Ce canon de bronze à fût octogonal, autrefois monté sur un affut à deux roues, est appelé fauconneau. Il s'agit d'une pièce d'apparat commandée par la famille Desch, qui y a fait sculpter ses armes et sa devise, la guimbarde. Le canon est daté et signé Maître Denis, qui peut identifier le fondeur mais aussi un possesseur ultérieur. La décoration de cette arme est très riche : les anses sont en forme de dragons, la culasse porte une harpie sculptée, les côtés de l'octogone sont ornés de décors architecturaux, de feuillages et de personnages masculins et féminins. Ce canon provient peut-être de Flandre, ou plus sûrement d'Allemagne du Sud, où des ateliers spécialisés produisent de tels objets de luxe à cette époque.
Fauconneau Desch Ce canon de bronze à fût octogonal, autrefois monté sur un affut à deux roues, est appelé fauconneau. Il s'agit d'une pièce d'apparat commandée par la famille Desch, qui y a fait sculpter ses armes et sa devise, la guimbarde. Le canon est daté et signé Maître Denis, qui peut identifier le fondeur mais aussi un possesseur ultérieur. La décoration de cette arme est très riche : les anses sont en forme de dragons, la culasse porte une harpie sculptée, les côtés de l'octogone sont ornés de décors architecturaux, de feuillages et de personnages masculins et féminins. Ce canon provient peut-être de Flandre, ou plus sûrement d'Allemagne du Sud, où des ateliers spécialisés produisent de tels objets de luxe à cette époque.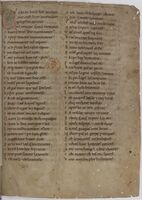 Evrat, La Genèse en vers (Paris, BNF, FR 12456) Metz (Moselle) ou Verdun (Meuse)
Evrat, La Genèse en vers (Paris, BNF, FR 12456) Metz (Moselle) ou Verdun (Meuse) Evrard Marlier (14..-1525) Evrard Marlier est le neveu du doyen du chapitre de la cathédrale Otton Savin. En 1470, il est son exécuteur testamentaire. Lui-même n'obtient qu'une demi-prébende de la cathédrale. Il meurt en 1525, faisant réaliser par son propre testament des legs promis par son oncle 55 ans auparavant, dont une verrière offerte à la cathédrale et réalisée par Valentin Bousch.
Evrard Marlier (14..-1525) Evrard Marlier est le neveu du doyen du chapitre de la cathédrale Otton Savin. En 1470, il est son exécuteur testamentaire. Lui-même n'obtient qu'une demi-prébende de la cathédrale. Il meurt en 1525, faisant réaliser par son propre testament des legs promis par son oncle 55 ans auparavant, dont une verrière offerte à la cathédrale et réalisée par Valentin Bousch.