-
 Plafond peint 12-14 rue du change : le bestiaire
Plafond peint 12-14 rue du change : le bestiaire Le plafond de la maison 12-14 rue du Change a été construit vers 1353-1356, mais les peintures, postérieures, datent possiblement des années 1419-1437. Le bestiaire de la rue du Change compte vingt figures dont une détruite à la démolition de la maison. On retrouve des animaux communs entourant la vie de l'homme et des animaux fantastiques, qui ne relevaient pas forcément de l'imaginaire au Moyen Âge. Parmi les animaux du commun, nous retrouvons deux lapins, un furet, une biche, un sanglier, deux chiens, un ours, un léopard, deux lions, deux singes et un éléphant ; pour les animaux fantastiques : trois dragons et serpents, un lion-dragon, un poisson-oiseau, un griffon, une licorne et un amphisbène.
Ces animaux aux attitudes variées, forment un programme réfléchi : une grande scène de chasse où certains animaux en chassent d'autres. Selon Nathalie Pascarel, les animaux apprivoisés (portant des colliers) chassant les animaux sauvages ou fantastiques évoquent les écus des princes chrétiens unis dans la croisade contre les Turcs.
-
 Place du Change
Place du Change La place du Change est une des trois grandes places de Metz, avec le Champ-à-Seille son voisin et la place de Chambre. Aujourd'hui appelée place Saint-Louis, elle a gardé la moitié de ses maisons anciennes. Celles-ci témoignent de l'essor de Metz hors des murs romains : la place est allongée car les maisons sont construites le long de la muraille antique, côté campagne. La place était donc dans les faubourgs, avant d'être intégrée dans l'enceinte des années 1220. Elle était alors entièrement entourée de maisons. Elle formait avec la place voisine, le Champ-à-Seille, le coeur commercial de la cité, car c'est là que se tenaient les marchés hebdomadaires. Les changeurs se sont installés sur la place, lui donnant son nom. De très nombreux événements urbains, fêtes, théâtre, joutes, se sont tenus place du Change.
-
 Place de Chambre
Place de Chambre La place de Chambre est située en contre-bas de la cathédrale : c'est une des trois grandes places médiévales de Metz, la seule qui soit située dans la cité antique, alors que le Champ-à-Seille et la place du Change sont le centre du faubourg marchand qui apparaît au XIIe siècle. Elle tire son nom soit de la « Camera » (chambre) de l'évêque, puisque le quartier était à l'origine sous son autorité, soit de l'hospice tenu par les frères de Saint-Jean, qui accueillait pèlerins et voyageurs entre la place et la Moselle.
En Chambre se tient un marché hebdomadaire des produits alimentaires. La place accueille quelques grands événements ; en 1485, 6000 spectateurs s'y pressent pour une pièce de théâtre, le Jeu de Sainte-Barbe. En 1492, quand la cité veut faire du supplice de Jean de Landremont un acte exemplaire, elle l'organise sur la place.
-
Pignon-Feller, Christiane, « Le fabuleux destin de Sainte-Ségolène »
Pignon-Feller, Christiane, « Le fabuleux destin de Sainte-Ségolène », Mémoires de l'Académie nationale de Metz, 2011, p. 217-249
-
Pierre-Marie Mercier (1981-)
Pierre-Marie Mercier est un historien français.
-
Pierre-Édouard Wagner (1949-)
Pierre-Édouard Wagner est un historien d'art et archéologue français. Il a été Conservateur à la Bibliothèque-Médiathèque de Metz.
-
Pierre Roucel (14..-1466)
Pierre Roucel est le fils de Nicolle Roucel dit de Vésigneul et de Marguerite de Toul. Il occupe plusieurs charges ecclésiastiques : chanoine de la Cathédrale de Metz et de Notre-Dame-la-Ronde, prévôt de St-Sauveur et curé de Saint-Ladre. Il meurt de la peste le 27 août 1466, lors de la terrible épidémie qui ravage la cité. Il choisit d'être enterré anonymement au cimetière Saint-Louis, avec les pauvres, plutôt que d'être inhumé dans un grand sanctuaire comme les notables laïcs ou ecclésiastiques.
-
Pierre Renguillon dit le Grand (13..-14..)
Pierre Renguillon dit le Grand est le fils de Jean Renguillon et de Catherine Baudoche. Il épouse Alix, fille de Guillaume de Heu et de Collette Lohier. Il meurt à une date inconnue après 1408.
-
Pierre Renguillon (14..-1475)
Pierre Renguillon est le fils de Jean Renguillon dit Bacon et de Alix Migomay. Il épouse en premières noces Collette, fille de Jean de Vaudrevange et de Perrette de Raigecourt. Après son décès en 1431, il se remarie rapidement avec Hillewy de Vatimont, qui meurt entre 1432 et 1441. Il convole ensuite en troisièmes noces avec Agnès de Ludres le 23 septembre 1441. Il meurt le premier janvier 1475 et son corps est inhumé en l'église Saint-Martin-en-Curtis dans la chapelle des Le Gronnais. La mort de son seul fils en 1447 entraîne la disparition du lignage des Renguillon.
-
Pierre Poulet (13..-1403)
Pierre Poulet (Petrus Pouleti ou Poleti en latin), chanoine de la cathédrale de Metz, est élu aumônier avant 1371 et réside à l'Aumônerie. Entre 1381 et 1387, il est maître de la fabrique avec Herpe de Rode et s'occupe des travaux du chœur de la cathédrale. Il décède en octobre 1403.
-
Pierre Perrat (13..-1400)
Pierre Perrat est surtout connu pour sa fonction de maître-maçon de la cathédrale Saint-Étienne de Metz à partir de 1383 au moins. Mais il travailla aussi au convent des Carmes de Metz et aux cathédrales de Toul et de Verdun. C'est peut-être par ce que son épitaphe est la seule des architectures à avoir été conservée dans la cathédrale que la légende s’est emparé de son nom : on lui a attribué l'ensemble de la cathédrale, qu'il n'aurait pu construire qu'au prix d'un pacte avec le diable. Architecte sans doute talentueux, il n'est qu'un des nombreux hommes de l'art qui se sont succédé sur le chantier de la cathédrale du XIIIe au XVIe siècle. Il obtient dès 1386 le droit de placer sa sépulture dans la cathédrale tant que « pour le temps de son décès, il soit bon fils de sainte église ». En 1387, il loue une maison au chapitre située en Porsaillis pour le prix de 9 livres et 100 sous. Après sa mort, c'est un certain maître André qui est élu par le chapitre pour lui succéder au titre de maître-maçon de la cathédrale, puis par Bernard Lathomi en 1439.
-
Pierre Parepat (14..-15..)
L'ascendance de Pierre Pairepat est inconnue. Il devient curé de Saint-Martin en 1482, et occupe encore cette charge en 1498. En 1500, il devient le parrain d'André, fils de Philippe de Vigneulles et de Zabeline Le Sarte. Il meurt à une date inconnue.
-
Pierre Nicolay, de Sierck (13..-1450)
Pierre Nicolay, dans sa forme latine Nicolas Petri, est un chanoine de la cathédrale de Metz. Il habite entre 1424 et 1450 dans la maison canoniale n°25 où il est mort. Selon Pelt, il est maître de la fabrique dès 1420.
-
Pierre Mendel (1907-1989)
-
Pierre Losey (14..-1491)
Pierre Losey est un chanoine messin membre du chapitre de la cathédrale. Il devient prêtre en 1467 et on sait qu'il était déjà chanoine avant le 2 Juin de la même année. En raison du conflit qui oppose la cité au chapitre cathédral, il fait parti des chanoines émigrant à Pont-à-Mousson en 1462. Le 3 Octobre 1472, il reçoit l'office d'écolâtre. On le retrouve 10 ans plus tard en 1483, lors d'une offrande à la ville venant du chapitre. On sait qu'il a détenu une maison canoniale, mais nous n'avons pas réussi à l'identifier hormis le fait qu'elle se situait en Chèvremont. Selon sa croix d'identité retrouvée lors des fouilles de la cathédrale en 1914, il est mort le 23 Juillet 1491. Il n'a pas réalisé de testament et on sait qu'une de ses maisons a été transférée à un autre chanoine. On sait aussi qu'il a été écolâtre.
-
Pierre le Mangeur, Histoire scolastique, partie 2 : Histoire évangélique (Metz, BM, ms. 239)
-
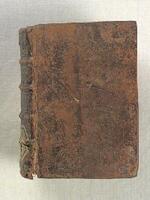 Pierre le Mangeur, Histoire scolastique (Metz, BM, ms. 129)
Pierre le Mangeur, Histoire scolastique (Metz, BM, ms. 129)
-
Pierre Flandrin (1301-1381)
Pierre Flandrin est un chanoine messin, membre du chapitre de la cathédrale. Il a été auditeur de la Rote, référendaire, doyen du chapitre de Bayeux, avant d'être créé cardinal-diacre de Saint-Eustache le 30 mai 1371. Par la suite, il est nommé vicaire à Rome et est exécuteur testamentaire du pape Grégoire IX. Il est nommé grand archidiacre au chapitre de Metz vers 1375, jusqu'à sa mort à Avignon le 23 Janvier 1381.
-
Pierre Dieudonné (14..-1466)
Pierre Dieudonné est le fils de Pierre Dieudonné et d'Alix Renguillon. Il poursuit d'abord une carrière ecclésiastique comme chanoine de la cathédrale. Mais lorsque son père et son seul frère Jean meurent de peste en 1439, il quitte le canonicat pour intégrer les paraiges. Il épouse alors une certaine Mariette. Comble de malchance, la famille est complètement décimée lors de l'épidémie de peste qui ravage la cité en 1466. Son épouse Mariette meurt le 20 avril enceinte, son corps est ouvert pour baptiser l'enfant ; ses trois filles Mariette, Alixette et Collette meurent au cours de l'été. Pierre meurt à son tour le 16 juillet 1466. Avec son décès s'éteint la lignée des Dieudonné.
-
Pierre de Sierck (13..-14..)
Pierre de Sierck est un chanoine de la cathédrale de Metz. Peu de choses sont connues de lui, mais on sait qu'en 1439, il habite la maison canoniale appelée la Haute-Pierre.
-
Pierre de Serrières dit l'Aîné (13..-144.)
Fils de Joffroy de Serrières et d'Isabelle de la Rappe, Pierre de Serrières est issu d'une branche cadette d'un petit lignage du Barrois, de la région de Pont-à-Mousson. Il s'installe à Metz et intègre le milieu des paraiges par son mariage avec Marguerite Corbé, riche héritière du patrimoine familial. En 1439, il rend hommage pour la maison-forte qu'il possède à Nomeny, la Cour des Serrières, et pour celles de son épouse : la moitié de l'avouerie épiscopale de Nomeny et la maison de la Cour des Voués.
-
Pierre de Saint-Dizier (13..-14..)
Pierre de Saint-Dizier est mentionné comme curé de la paroisse Saint-Eucaire, en Outre-Seille, de 1416 à 1445. On ignore tout de sa formation : il se dit maître, ce qui laisse envisager une formation scolaire ou universitaire. Dans les années 1430-1445, il rédige une chronique, la première de grande ampleur écrite en français à Metz. Il meurt entre 1445, quand son œuvre s'interrompt assez brutalement, et 1456, date à laquelle un autre curé est mentionné à Saint-Eucaire.
-
Pierre de Raigecourt dit Xappel (12..-1...)
Pierre de Raigecourt dit Xappel est le fils de Poince de Raigecourt et d'une certaine Perratte. Il semble avoir été le fils aîné, héritant des terres de Corny. Il épouse Mahaut, dont l'ascendance est inconnue avec qui il a trois enfants qui nous soient connus : Joffroy, Jean et Perratte. Il meurt entre 1298 et 1312.
-
Pierre de Monteruc (13..-1369)
Pierre de Monteruc est un chanoine de la cathédrale de Metz. Il est le neveu du pape Innocent VI par sa mère. Il obtient plusieurs dignités dans les différentes communautés canoniales, à Amiens, Elne, Avranches, Bayeux et Lille. Il obtient la charge de trésorier de Metz entre 1375 et 1380. Il connaît le Grand Schisme à la fin de sa vie, et se rallie à Clément VII à Avignon où il y meurt le 20 mai 1385.
-
Pierre de Luxembourg (1369-1387)
Pierre de Luxembourg a été le 75e évêque de Metz. Il est le fils de Guy de Luxembourg et de Mahaut de Châtillon. Il appartient donc à la branche cadette des Luxembourg, comtes de Ligny-en-Barrois, tandis que le roi Wenceslas, de la branche aînée, règne sur le Saint-Empire. En 1384, il est nommé évêque de Metz à l'âge de seulement 15 ans par le pape Clément VII à Avignon. En 1386, il est également nommé cardinal d'Avignon. Il meurt moins d'un an plus tard, le 2 juillet 1387, à 18 ans, en raison, dit-on, de son mode de vie austère. Son tombeau à Villeneuve-lès-Avignon est rapidement vénéré après sa mort, si bien qu'un procès de canonisation débute en 1390. Mais après la mort du pape Clément VII en 1397, le procès est abandonné et jamais repris. Pierre de Luxembourg n'a jamais été canonisé, mais il est proclamé bienheureux à Rome en 1527. Si son tombeau se trouve à Villeneuve-lès-Avignon, on fit construire un gisant à sa mémoire dans la cathédrale Saint-Étienne de Metz, dont Louis Boudan fournit le relevé à la fin du XVIIe siècle.
 Plafond peint 12-14 rue du change : le bestiaire Le plafond de la maison 12-14 rue du Change a été construit vers 1353-1356, mais les peintures, postérieures, datent possiblement des années 1419-1437. Le bestiaire de la rue du Change compte vingt figures dont une détruite à la démolition de la maison. On retrouve des animaux communs entourant la vie de l'homme et des animaux fantastiques, qui ne relevaient pas forcément de l'imaginaire au Moyen Âge. Parmi les animaux du commun, nous retrouvons deux lapins, un furet, une biche, un sanglier, deux chiens, un ours, un léopard, deux lions, deux singes et un éléphant ; pour les animaux fantastiques : trois dragons et serpents, un lion-dragon, un poisson-oiseau, un griffon, une licorne et un amphisbène. Ces animaux aux attitudes variées, forment un programme réfléchi : une grande scène de chasse où certains animaux en chassent d'autres. Selon Nathalie Pascarel, les animaux apprivoisés (portant des colliers) chassant les animaux sauvages ou fantastiques évoquent les écus des princes chrétiens unis dans la croisade contre les Turcs.
Plafond peint 12-14 rue du change : le bestiaire Le plafond de la maison 12-14 rue du Change a été construit vers 1353-1356, mais les peintures, postérieures, datent possiblement des années 1419-1437. Le bestiaire de la rue du Change compte vingt figures dont une détruite à la démolition de la maison. On retrouve des animaux communs entourant la vie de l'homme et des animaux fantastiques, qui ne relevaient pas forcément de l'imaginaire au Moyen Âge. Parmi les animaux du commun, nous retrouvons deux lapins, un furet, une biche, un sanglier, deux chiens, un ours, un léopard, deux lions, deux singes et un éléphant ; pour les animaux fantastiques : trois dragons et serpents, un lion-dragon, un poisson-oiseau, un griffon, une licorne et un amphisbène. Ces animaux aux attitudes variées, forment un programme réfléchi : une grande scène de chasse où certains animaux en chassent d'autres. Selon Nathalie Pascarel, les animaux apprivoisés (portant des colliers) chassant les animaux sauvages ou fantastiques évoquent les écus des princes chrétiens unis dans la croisade contre les Turcs. Place du Change La place du Change est une des trois grandes places de Metz, avec le Champ-à-Seille son voisin et la place de Chambre. Aujourd'hui appelée place Saint-Louis, elle a gardé la moitié de ses maisons anciennes. Celles-ci témoignent de l'essor de Metz hors des murs romains : la place est allongée car les maisons sont construites le long de la muraille antique, côté campagne. La place était donc dans les faubourgs, avant d'être intégrée dans l'enceinte des années 1220. Elle était alors entièrement entourée de maisons. Elle formait avec la place voisine, le Champ-à-Seille, le coeur commercial de la cité, car c'est là que se tenaient les marchés hebdomadaires. Les changeurs se sont installés sur la place, lui donnant son nom. De très nombreux événements urbains, fêtes, théâtre, joutes, se sont tenus place du Change.
Place du Change La place du Change est une des trois grandes places de Metz, avec le Champ-à-Seille son voisin et la place de Chambre. Aujourd'hui appelée place Saint-Louis, elle a gardé la moitié de ses maisons anciennes. Celles-ci témoignent de l'essor de Metz hors des murs romains : la place est allongée car les maisons sont construites le long de la muraille antique, côté campagne. La place était donc dans les faubourgs, avant d'être intégrée dans l'enceinte des années 1220. Elle était alors entièrement entourée de maisons. Elle formait avec la place voisine, le Champ-à-Seille, le coeur commercial de la cité, car c'est là que se tenaient les marchés hebdomadaires. Les changeurs se sont installés sur la place, lui donnant son nom. De très nombreux événements urbains, fêtes, théâtre, joutes, se sont tenus place du Change. Place de Chambre La place de Chambre est située en contre-bas de la cathédrale : c'est une des trois grandes places médiévales de Metz, la seule qui soit située dans la cité antique, alors que le Champ-à-Seille et la place du Change sont le centre du faubourg marchand qui apparaît au XIIe siècle. Elle tire son nom soit de la « Camera » (chambre) de l'évêque, puisque le quartier était à l'origine sous son autorité, soit de l'hospice tenu par les frères de Saint-Jean, qui accueillait pèlerins et voyageurs entre la place et la Moselle. En Chambre se tient un marché hebdomadaire des produits alimentaires. La place accueille quelques grands événements ; en 1485, 6000 spectateurs s'y pressent pour une pièce de théâtre, le Jeu de Sainte-Barbe. En 1492, quand la cité veut faire du supplice de Jean de Landremont un acte exemplaire, elle l'organise sur la place.
Place de Chambre La place de Chambre est située en contre-bas de la cathédrale : c'est une des trois grandes places médiévales de Metz, la seule qui soit située dans la cité antique, alors que le Champ-à-Seille et la place du Change sont le centre du faubourg marchand qui apparaît au XIIe siècle. Elle tire son nom soit de la « Camera » (chambre) de l'évêque, puisque le quartier était à l'origine sous son autorité, soit de l'hospice tenu par les frères de Saint-Jean, qui accueillait pèlerins et voyageurs entre la place et la Moselle. En Chambre se tient un marché hebdomadaire des produits alimentaires. La place accueille quelques grands événements ; en 1485, 6000 spectateurs s'y pressent pour une pièce de théâtre, le Jeu de Sainte-Barbe. En 1492, quand la cité veut faire du supplice de Jean de Landremont un acte exemplaire, elle l'organise sur la place.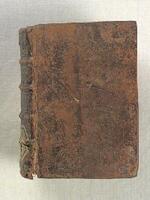 Pierre le Mangeur, Histoire scolastique (Metz, BM, ms. 129)
Pierre le Mangeur, Histoire scolastique (Metz, BM, ms. 129) 