-
Poincerelle Le Gronnais (1...-1430)
Poincerelle Le Gronnais est la fille de Jean Le Gronnais et de Collette Baudoche. Elle épouse Collin Paillat avec qui elle a un enfant qui nous soit connu : Burtignon Paillat. Collin meurt en septembre 1429 et Poincerelle meurt à son tour sans doute encore jeune adulte le 4 septembre 1430. Son corps est enseveli au couvent des Célestins. Son fils meurt deux jours plus tard le 6 septembre 1430. C'est la fin du lignage des Paillat à Metz.
-
Poince Ruece (12..-13..)
L'ascendance de Poince Ruece est inconnue, mais il s'agit d'une famille qui était liée aux paraiges. Elle épouse Nicolle de la Court avec qui elle a 5 enfants qui nous soient connus. Avec son fils Jean de la Court, elle fonde l'abbaye du Pontiffroy en 1321. Elle meurt à une date inconnue.
-
Poince Roucel (14..-1478)
Poince Roucel est le fils de Werry Roucel et de Catherine Baudoche. Il épouse Claude de Serrières en septembre 1476. Mais le mariage est de courte durée. Poince meurt en avril 1478, laissant Catherine veuve, qui se remarie avec Antoine de Norroy en 1480.
-
Poince Louve (13..-1400)
Poince Louve est le fils de Jean Louve et d'une certaine Marguerite. Il se marie à une date inconnue avec Perrette, fille de Jean Baudoche et de Jennette de Heu. Il meurt en septembre 1400. Son corps est inhumé au couvent des Célestins.
-
Poince Le Gronnais dit des Changes (13..-13..)
Poince Le Gronnais dit des Changes est le fils de Poince Le Gronnais dit l'Aveugle et d'une certaine Contesse. Il épouse en premières noces Béatrice, fille de Thiébaut Moyelan et d'une certaine Catherine. Il est adoubé lors de la visite impériale de Charles IV à Metz en 1356. Devenu veuf à une date incertaine entre 1337 et 1363, il épouse en secondes noces Isabelle Marcoul, qui hérite à la mort de son frère de l'héritage familial. Il meurt avant 1373, laissant Isabelle veuve.
-
Poince Le Gronnais (13..-1340)
Poince Le Gronnais est la fille de Collard Le Gronnais et d'une certaine Idette. Elle épouse Ingrand Burchon, avec qui elle a de nombreux enfants. Elle meurt sans doute encore jeune adulte le 15 juillet 1340, laissant Ingrand veuf. Son corps est enseveli au couvent des Cordeliers (aujourd'hui le cloître des Récollets) avec celui de sa fille Jacomette.
-
Poince Guenordin (13..-136.)
Poince ou Poincignon Guenordin est le fils de Jean Guenordin et d'une certaine Lorette. Il épouse Isabelle, fille Thiébaut de Heu et d'Alix de la Court. Il meurt entre 1365 et 1367, laissant Isabelle veuve.
-
Poince Grognat (13..-14..)
Poince Grognat est l'un des trois fils de Joffroy Grognat et de Poincette Dieu-Ami. Il est, avec son frère Nicolle, à la tête du parti favorable dans la cité au duc de Lorraine, Charles II, et au roi des Romains Robert de Bavière. En 1417, il offre un collier d'or au trésor de la cathédrale pour enrichir le buste-reliquaire de saint Étienne. Il épouse Marguerite, fille de Henri Chevallat et de Perrette Roillenat. Poince meurt entre 1417 et 1420 sans descendance.
-
Poince de Vy (13..-1451)
Fille de Jean de Vy et de Béatrice Le Hungre, Poince de Vy est la première et seule épouse de Jacques I Desch avec qui elle se marie à une date inconnue entre 1395 et 1401. Elle meurt le 24 mars 1451, laissant son époux veuf. Sa sépulture se trouve au couvent des Célestins.
-
Poince de Vy (13..-1396)
Poince de Vy est la fille de Poince de Vy et de Marguerite de La Court. Elle épouse Jean Brady dit du Neufbourg. Elle meurt veuve en septembre 1396.
-
Poince de Vy (13..-1372)
Poince ou Poincignon de Vy est le fils de Jean de Vy et d'une fille de Thiébaut Fourat. Il épouse Marguerite de La Court avec qui il a trois enfants qui nous sont connus. Il meurt le 30 mai 1372 et son corps est inhumé au couvent des Cordeliers (aujourd'hui le cloître des Récollets).
-
Poince de Laître (13..-13..)
Poince de Laître est le fils de Thiébaut de Laître et de Contesse de Heu. Il se marie avec une certaine Contesse. Il meurt entre 1356 et 1362, laisse son épouse veuve.
-
Poince Baudoche (14..-1465)
Poince Baudoche est le fils d'Arnould Baudoche et d'Isabelle Le Gronnais. Il épouse en premières noces Marguerite de Vy. Il s'agit d'un double mariage : son frère Jean Baudoche épouse Béatrice, la soeur de Marguerite. Après la mort de son épouse avant 1436, il convole en secondes noces avec Catherine Le Gronnais, veuve de Jacques Le Hungre. Il laisse veuve à son décès le 23 avril 1465 et son corps est inhumé à l'église Saint-Martin-en-Curtis.
-
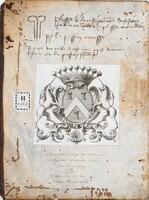 Plusieurs bials enssignement d'Aristotes fait a Allixandre et plusieurs morallitez (Montpellier, BU, ms. H 164)
Plusieurs bials enssignement d'Aristotes fait a Allixandre et plusieurs morallitez (Montpellier, BU, ms. H 164)
-
Plaque de fondation de la chapelle Saint-Georges et Saint-Éloi (XIVe siècle)
En l'église Saint-Maximin se trouve encore de nos jours la plaque de fondation de la chapelle Saint-Georges et Saint-Éloi, par Poincignon Dieu-Ami et Alixette sa femme, datée du 27 juillet 1365. La chapelle devient par la suite la chapelle des Gronnais et lieu important d'inhumation du lignage.
Selon les anciennes observations, les lettres saillantes auraient été colorées de jaune et de rouge sur fond noir. La plaque, composée de trois dalles en pierre de Jaumont, se situait dans le mur entre l'autel et l'entrée de la chapelle.
En voici la traduction : « Poincignon Dieu-Ami l'aman et Alixette, sa femme, ont fait faire cette chapelle et fondé au nom de monseigneur saint Georges et de monseigneur saint Éloi et fut dédiée le dimanche après la Madeleine par M CCC et LXV ans (27 juillet 1365). Et ils y ont ordonné III chapelains perpétuels pour toujours et doivent chacun desdits chapelains pour chaque semaine chanter en ladite chapelle IIII messes. Priez Dieu qu'il ait merci de leurs âmes. Amen ».
-
Plan Belle-Isle
Metz (Moselle)
-
 Plafonds peints « du Républicain lorrain »
Plafonds peints « du Républicain lorrain » Ces plafonds ont été découverts dans les locaux du Républicain lorrain, d'où leur surnom. Ils sont uniques en leur genre car quasiment entier et dans un bon état de conservation. Cachés au-dessus d'un faux plafonds au cours du XIXème siècle, ils sont retrouvés en 1984 lors du déménagement des locaux du Journal le Républicain Lorrain. On y voit plus de 36 armoiries dont celle du royaume de France (d'azur à trois fleurs de lys d'or), qui sont fixées en 1378, ainsi que les les armoiries d'un pape d'Avignon, Grégoire XI. Les armoiries de Clément VII, antipape d'Avignon s'y trouvent aussi tout comme celle de l'Empire germanique ou encore du royaume de Hongrie. Le plafond se trouve dans la maison dans un espace situé au Rez-de-chaussée, constituant le plancher du premier étage. Sur la totalité du plafond, 42 blasons y figurent
-
 Plafond peint, 8 rue Poncelet
Plafond peint, 8 rue Poncelet Ce plafond a été peint sur des planches de chêne assemblées au début du XIIIe siècle. La peinture est l'oeuvre d'au moins deux peintres anonymes, un maître et son apprenti , et elle est postérieure : datée de la deuxième moitié du XIIIe siècle, elle n'était donc pas prévue à l'origine.
Ce plafond peint de style encore roman représente un bestiaire. L'iconographie est très riche et encore largement mystérieuse ; on y trouve des animaux, des végétaux, des êtres hybrides et des signes astrologiques.
Le plafond a été redécouvert en 1896 lors des rénovation de l'ancienne École supérieure de jeunes filles, une ancienne maison canoniale de la cathédrale au Moyen Âge. Les plafonds peints avaient été protégés par un faux plafond de plâtre. Il était situé au rez-de-chaussée, dans une pièce à vivre, où les chanoines passaient leur temps, selon l'historien Jérôme Fronty.
Le musée conserve 11 fragments de solives et 295 planches. 11 planches ont disparu. On compte deux parties du plafond : 58 médaillons ornés de personnages dans la première, 29 dans l'autre, entre les solives ornées de motifs décoratifs.
-
 Plafond peint rue Poncelet : Iconographie végétale
Plafond peint rue Poncelet : Iconographie végétale Des motifs floraux tout autour des différents médaillons accompagnaient le décor du plafond peint, en reliant chaque élément. A cause de la mauvaise conservation des solives, nous n’avons plus que les relevés réalisés par l’architecte Wilhelm Schmitz.
Les représentations florales sont particulièrement courantes aux XIIIe et XIVe siècle à Metz : « près de 74% des vestiges [qui] sont ornés de rinceaux ». Ils servent à mettre en valeur les représentations présentes dans les médaillons. Parfois, les motifs floraux se mêlent aux représentations animales.
-
 Plafond peint rue Poncelet : Iconographie hybride
Plafond peint rue Poncelet : Iconographie hybride Les êtres hybrides sont la fusion d'un humain et d'un animal (sirène, poisson christique...). Les peintures d'hommes à capuche peuvent être interprétées comme des représentations de chanoines chimériques. Cette iconographie s'explique par l'origine du plafond peint dans une maison canoniale de Metz, localisée au 8 rue Poncelet. La symbolique évoque le parallèle entre le monde marin et le monde terrestre tel qu'il est pensé au XIIIe siècle. On peut également y voir le symbole d'un combat entre bien et mal, l'homme face au malin.
-
 Plafond peint rue Poncelet : Iconographie astrologique
Plafond peint rue Poncelet : Iconographie astrologique Certaines figures du plafond peint du 8 rue Poncelet peuvent être des signes astrologiques : le Cancer, les Gémeaux, peut-être également le Lion et le Poisson. Le signe du Gémeaux pourrait venir du Liber astrologiae de Georgius Zothorus. Nathalie Pascarel associe et compare d’ailleurs ces représentations aux signes astrologiques de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Néanmoins, le reste des éléments, voulus par le commanditaire, sont peut-être en lien avec son calendrier personnel.
-
 Plafond peint rue Poncelet : Iconographie animale
Plafond peint rue Poncelet : Iconographie animale Sur les 27 plafonds peints messins datant du Moyen Âge, seuls quatre d'entre eux contiennent des animaux (15%). Les figures animales du plafond rue Poncelet forment un bestiaire. Il faut entendre par ce terme, au Moyen âge, des représentations animales, réelles ou non, qui revêtent également des significations symboliques. Ainsi le poisson est l'image du Christ et de la protection.
-
Plafond peint du 1, rue de l'Abbé-Risse, 29 en Jurue
Un plafond peint a été découvert à la fin du XIXe siècle dans une des trois pièces du rez-de-chaussée de la maison des Lombards. Le bois des planches est daté d'environ 1320, mais les peintures héraldiques peuvent dater de la première moitié du XVe siècle. Leur lecture est difficile car elles sont mal conservées, à l'exception de saumons héraldiques. Les premières études identifiaient les écus avec ceux des comtes de Blâmont et des sires vosgiens de Herbéviller, mais N. Pascarel a contesté cette lecture : les saumons blancs sur fond rouge de Blâmont ne sont pas accompagnés de croisettes. Il est possible que les armoiries soient celles des comtes de Salm et des sires bourguignons de Chastellux ou de Chauvirey.
-
 Plafond peint des Carmélites
Plafond peint des Carmélites Le musée de la Cour d'Or conserve un plafond peint qui provient du couvent des Carmélites, possible vestige de l'hôtel Chaverson. Ces planches sont découvertes dans une pièce du rez-de-chaussée en 1896. Elles ont été assez fortement dégradées et sont conservées en réserve. En 1899, on y voyait des décors géométriques (entrelacs à motifs floraux), des animaux (un coq, deux animaux, peut-être des renards, affrontés), un cavalier, ainsi que deux écus, aujourd'hui disparus, aux armoiries nonidentifiées. On conserve aujourd'hui 22 planches dont 9 au moins présentent, encore lisibles, des mailles jaunes entrelacées au centre desquelles on aperçoit de petites fleurs rouges à cinq pétales.
-
Plafond peint de la maison 12-14 rue du Change
Ce plafond peint est remarquable et comprend un bestiaire, un armorial et un décor de rinceaux. L'archéo-dendrométrie a daté le bois de sapin de ce plafond vers 1353-1356. Elles sont rapportées à la visite de l'empereur Charles IV et de sa femme, l'impératrice Anne de Silésie, à Metz en 1356 par Jean-Claude Loutsch. Nathalie Pascarel interprète différemment les écus représentés et date les peintures du règne de l'empereur Sigismond dans les années 1419-1437.
Le plafond a été découvert en 1964 lors d'une période de rénovation et de destruction massive du centre-ville de Metz et déposé au musée de la Cour d'Or.
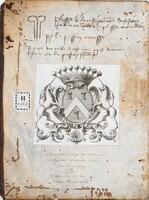 Plusieurs bials enssignement d'Aristotes fait a Allixandre et plusieurs morallitez (Montpellier, BU, ms. H 164)
Plusieurs bials enssignement d'Aristotes fait a Allixandre et plusieurs morallitez (Montpellier, BU, ms. H 164)  Plafonds peints « du Républicain lorrain » Ces plafonds ont été découverts dans les locaux du Républicain lorrain, d'où leur surnom. Ils sont uniques en leur genre car quasiment entier et dans un bon état de conservation. Cachés au-dessus d'un faux plafonds au cours du XIXème siècle, ils sont retrouvés en 1984 lors du déménagement des locaux du Journal le Républicain Lorrain. On y voit plus de 36 armoiries dont celle du royaume de France (d'azur à trois fleurs de lys d'or), qui sont fixées en 1378, ainsi que les les armoiries d'un pape d'Avignon, Grégoire XI. Les armoiries de Clément VII, antipape d'Avignon s'y trouvent aussi tout comme celle de l'Empire germanique ou encore du royaume de Hongrie. Le plafond se trouve dans la maison dans un espace situé au Rez-de-chaussée, constituant le plancher du premier étage. Sur la totalité du plafond, 42 blasons y figurent
Plafonds peints « du Républicain lorrain » Ces plafonds ont été découverts dans les locaux du Républicain lorrain, d'où leur surnom. Ils sont uniques en leur genre car quasiment entier et dans un bon état de conservation. Cachés au-dessus d'un faux plafonds au cours du XIXème siècle, ils sont retrouvés en 1984 lors du déménagement des locaux du Journal le Républicain Lorrain. On y voit plus de 36 armoiries dont celle du royaume de France (d'azur à trois fleurs de lys d'or), qui sont fixées en 1378, ainsi que les les armoiries d'un pape d'Avignon, Grégoire XI. Les armoiries de Clément VII, antipape d'Avignon s'y trouvent aussi tout comme celle de l'Empire germanique ou encore du royaume de Hongrie. Le plafond se trouve dans la maison dans un espace situé au Rez-de-chaussée, constituant le plancher du premier étage. Sur la totalité du plafond, 42 blasons y figurent Plafond peint, 8 rue Poncelet Ce plafond a été peint sur des planches de chêne assemblées au début du XIIIe siècle. La peinture est l'oeuvre d'au moins deux peintres anonymes, un maître et son apprenti , et elle est postérieure : datée de la deuxième moitié du XIIIe siècle, elle n'était donc pas prévue à l'origine. Ce plafond peint de style encore roman représente un bestiaire. L'iconographie est très riche et encore largement mystérieuse ; on y trouve des animaux, des végétaux, des êtres hybrides et des signes astrologiques. Le plafond a été redécouvert en 1896 lors des rénovation de l'ancienne École supérieure de jeunes filles, une ancienne maison canoniale de la cathédrale au Moyen Âge. Les plafonds peints avaient été protégés par un faux plafond de plâtre. Il était situé au rez-de-chaussée, dans une pièce à vivre, où les chanoines passaient leur temps, selon l'historien Jérôme Fronty. Le musée conserve 11 fragments de solives et 295 planches. 11 planches ont disparu. On compte deux parties du plafond : 58 médaillons ornés de personnages dans la première, 29 dans l'autre, entre les solives ornées de motifs décoratifs.
Plafond peint, 8 rue Poncelet Ce plafond a été peint sur des planches de chêne assemblées au début du XIIIe siècle. La peinture est l'oeuvre d'au moins deux peintres anonymes, un maître et son apprenti , et elle est postérieure : datée de la deuxième moitié du XIIIe siècle, elle n'était donc pas prévue à l'origine. Ce plafond peint de style encore roman représente un bestiaire. L'iconographie est très riche et encore largement mystérieuse ; on y trouve des animaux, des végétaux, des êtres hybrides et des signes astrologiques. Le plafond a été redécouvert en 1896 lors des rénovation de l'ancienne École supérieure de jeunes filles, une ancienne maison canoniale de la cathédrale au Moyen Âge. Les plafonds peints avaient été protégés par un faux plafond de plâtre. Il était situé au rez-de-chaussée, dans une pièce à vivre, où les chanoines passaient leur temps, selon l'historien Jérôme Fronty. Le musée conserve 11 fragments de solives et 295 planches. 11 planches ont disparu. On compte deux parties du plafond : 58 médaillons ornés de personnages dans la première, 29 dans l'autre, entre les solives ornées de motifs décoratifs. Plafond peint rue Poncelet : Iconographie végétale Des motifs floraux tout autour des différents médaillons accompagnaient le décor du plafond peint, en reliant chaque élément. A cause de la mauvaise conservation des solives, nous n’avons plus que les relevés réalisés par l’architecte Wilhelm Schmitz. Les représentations florales sont particulièrement courantes aux XIIIe et XIVe siècle à Metz : « près de 74% des vestiges [qui] sont ornés de rinceaux ». Ils servent à mettre en valeur les représentations présentes dans les médaillons. Parfois, les motifs floraux se mêlent aux représentations animales.
Plafond peint rue Poncelet : Iconographie végétale Des motifs floraux tout autour des différents médaillons accompagnaient le décor du plafond peint, en reliant chaque élément. A cause de la mauvaise conservation des solives, nous n’avons plus que les relevés réalisés par l’architecte Wilhelm Schmitz. Les représentations florales sont particulièrement courantes aux XIIIe et XIVe siècle à Metz : « près de 74% des vestiges [qui] sont ornés de rinceaux ». Ils servent à mettre en valeur les représentations présentes dans les médaillons. Parfois, les motifs floraux se mêlent aux représentations animales. Plafond peint rue Poncelet : Iconographie hybride Les êtres hybrides sont la fusion d'un humain et d'un animal (sirène, poisson christique...). Les peintures d'hommes à capuche peuvent être interprétées comme des représentations de chanoines chimériques. Cette iconographie s'explique par l'origine du plafond peint dans une maison canoniale de Metz, localisée au 8 rue Poncelet. La symbolique évoque le parallèle entre le monde marin et le monde terrestre tel qu'il est pensé au XIIIe siècle. On peut également y voir le symbole d'un combat entre bien et mal, l'homme face au malin.
Plafond peint rue Poncelet : Iconographie hybride Les êtres hybrides sont la fusion d'un humain et d'un animal (sirène, poisson christique...). Les peintures d'hommes à capuche peuvent être interprétées comme des représentations de chanoines chimériques. Cette iconographie s'explique par l'origine du plafond peint dans une maison canoniale de Metz, localisée au 8 rue Poncelet. La symbolique évoque le parallèle entre le monde marin et le monde terrestre tel qu'il est pensé au XIIIe siècle. On peut également y voir le symbole d'un combat entre bien et mal, l'homme face au malin. Plafond peint rue Poncelet : Iconographie astrologique Certaines figures du plafond peint du 8 rue Poncelet peuvent être des signes astrologiques : le Cancer, les Gémeaux, peut-être également le Lion et le Poisson. Le signe du Gémeaux pourrait venir du Liber astrologiae de Georgius Zothorus. Nathalie Pascarel associe et compare d’ailleurs ces représentations aux signes astrologiques de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Néanmoins, le reste des éléments, voulus par le commanditaire, sont peut-être en lien avec son calendrier personnel.
Plafond peint rue Poncelet : Iconographie astrologique Certaines figures du plafond peint du 8 rue Poncelet peuvent être des signes astrologiques : le Cancer, les Gémeaux, peut-être également le Lion et le Poisson. Le signe du Gémeaux pourrait venir du Liber astrologiae de Georgius Zothorus. Nathalie Pascarel associe et compare d’ailleurs ces représentations aux signes astrologiques de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Néanmoins, le reste des éléments, voulus par le commanditaire, sont peut-être en lien avec son calendrier personnel. Plafond peint rue Poncelet : Iconographie animale Sur les 27 plafonds peints messins datant du Moyen Âge, seuls quatre d'entre eux contiennent des animaux (15%). Les figures animales du plafond rue Poncelet forment un bestiaire. Il faut entendre par ce terme, au Moyen âge, des représentations animales, réelles ou non, qui revêtent également des significations symboliques. Ainsi le poisson est l'image du Christ et de la protection.
Plafond peint rue Poncelet : Iconographie animale Sur les 27 plafonds peints messins datant du Moyen Âge, seuls quatre d'entre eux contiennent des animaux (15%). Les figures animales du plafond rue Poncelet forment un bestiaire. Il faut entendre par ce terme, au Moyen âge, des représentations animales, réelles ou non, qui revêtent également des significations symboliques. Ainsi le poisson est l'image du Christ et de la protection. Plafond peint des Carmélites Le musée de la Cour d'Or conserve un plafond peint qui provient du couvent des Carmélites, possible vestige de l'hôtel Chaverson. Ces planches sont découvertes dans une pièce du rez-de-chaussée en 1896. Elles ont été assez fortement dégradées et sont conservées en réserve. En 1899, on y voyait des décors géométriques (entrelacs à motifs floraux), des animaux (un coq, deux animaux, peut-être des renards, affrontés), un cavalier, ainsi que deux écus, aujourd'hui disparus, aux armoiries nonidentifiées. On conserve aujourd'hui 22 planches dont 9 au moins présentent, encore lisibles, des mailles jaunes entrelacées au centre desquelles on aperçoit de petites fleurs rouges à cinq pétales.
Plafond peint des Carmélites Le musée de la Cour d'Or conserve un plafond peint qui provient du couvent des Carmélites, possible vestige de l'hôtel Chaverson. Ces planches sont découvertes dans une pièce du rez-de-chaussée en 1896. Elles ont été assez fortement dégradées et sont conservées en réserve. En 1899, on y voyait des décors géométriques (entrelacs à motifs floraux), des animaux (un coq, deux animaux, peut-être des renards, affrontés), un cavalier, ainsi que deux écus, aujourd'hui disparus, aux armoiries nonidentifiées. On conserve aujourd'hui 22 planches dont 9 au moins présentent, encore lisibles, des mailles jaunes entrelacées au centre desquelles on aperçoit de petites fleurs rouges à cinq pétales.