-
Prost, Auguste, « Notice sur deux chroniques messines des quinzième et seizième siècles »
Prost, Auguste, « Notice sur deux chroniques messines des quinzième et seizième siècles », Mémoires de l'Académie nationale de Metz, 40, 1858-1859, p. 215-242.
-
Prost, Auguste, « Le patriciat dans la cité de Metz »
Prost, Auguste, « Le patriciat dans la cité de Metz », Mémoires de la Société nationale des Antiquaires de France, vol. 34 (1873), p.1-273.
-
Prost, Auguste, « Le Passe-Temps »
Prost, Auguste, « Le Passe-Temps », L'Union des Arts, revue littéraire et artistique, Metz, 1852, t. 2, p. 249-273.
-
Prost, Auguste, « Inscription à l'oratoire des Templiers »
Prost, Auguste, « Inscription à l'oratoire des Templiers », Bulletin de la société d'histoire et d'archéologie de la Moselle, 1864, p. 146.
-
Prost, August, « La mort d'Androuin Roucel »
Prost, August, « La mort d'Androuin Roucel », L'Austrasie, revue de Metz et de Lorraine, vol. 2, 1854, p. 87-109.
-
Primicier, ou princier
Le primicier, ou princier, est le premier dignitaire du chapitre de la cathédrale Saint-Étienne de Metz, avant le doyen, le chantre, le chancelier et le trésorier.
Étymologiquement, le primicier, primicerius en latin, est le « primus in cera », c’est-à-dire le « premier inscrit sur la tablette de cire ». Le concile de Nicée II, en 787, ordonnait à chaque évêque d’avoir dans sa cathédrale, outre l’archiprêtre et l’archidiacre, un primicier, sans préciser ses fonctions. En tant que premier chanoine, il se voit attribuer des responsabilités dans la direction des cérémonies liturgiques. À Rome, le primicier est désigné comme le directeur de l’enseignement et du chant. A la fin du premier millénaire, le primicier exerçait peut-être aussi cette fonction à Metz. A la fin du Moyen Âge, le primicier est à la tête des chanoines et préside les séances au chapitre. Il joue également un rôle politique : avec les grand abbés bénédictins, il tire au sort le nom du maître-échevin à chaque fête de Saint-Beoît (21 mars).
-
Prévôt
La prévôté fait partie des offices, dits secondaires au sein d'un chapitre. Ce dernier est désigné par les autres membres pour un temps limité, généralement de deux ans. Ces sous-officiers ou familiers (serviteurs) sont au service de l’église, de la cuisine, de la vie matérielle de la communauté. Le prévôt (praepositus) est l’adjoint du chef de la communauté. Il est nommé par l’évêque.
Dans l’ordre hiérarchique du diocèse, il vient après les archidiacres. L’office de praepositus était le plus ancien. Sa présence est antérieure à l’établissement du chapitre. Il est, aux côtés de l’évêque, le personnage le plus important de la communauté cléricale. Il est chargé de la gestion des domaines et des seigneuries appartenant au chapitre. Le concile de Cologne de 1260 définit la fonction des prévôts résidants dans la cathédrale, notamment de celui qui est chargé de veiller à la conservation du temporel de l’église et d’en être le dépositaire des revenus.
-
Portrait de Bertrand Le Hungre aux Célestins
Bertrand Le Hungre fonde le couvent des Célestins et passe les 30 dernières années de sa vie à le doter et l'agrandir. Après sa mort, sa mémoire y est soigneusement entretenue. Dans le réfectoire du couvent, une peinture sur bois le représentait, connue par une longue description textuelle du XVIIIe siècle. Bertrand était représenté vieux, la barbe et les cheveux blancs, en habit de religieux, devant un plan de son couvent, son écu figuré au-dessus de sa main droite. Un titre était peint : « Le vrai portrait du noble seigneur Bertrand Le Hungre, fondateur de ce couvent le 11 janvier 1370, qui mourut le 24 décembre 1397 » (« Vera effigies nobilis viri dni Bertrandi le Hungre qui hoc fondavit coenobium anno Domini 1370 11 januarii, obiit autem anno 1397 24 decemb. »).
La description ne permet pas de dater précisément la peinture. Le fond abstrait (« brocardé ou damasquiné en forme d'espèces de roses et de feuilles rouges mêlées de quelques traits de bleu et de blanc ») plaiderait plutôt pour une œuvre du XVe siècle.
-
Portier
La charge de portier (portarius en latin) est mentionnée dans la Règle de Chrodegang (755/757). Il y est écrit que le portier a pour mission, accompagné d'un frère plus jeune, de garder les portes pendant un an. Le soir, lors de la Complies, il a pour mission de donner les clefs à l'archidiacre.
Les portes du « claustrum » sont au nombres de quatre. Les trois premières donnent sur les sanctuaires de Saint-Étienne, de Saint-Pierre et de Sainte-Marie. La dernière est appelée porte du cloître. Les portes sont toutes fermées après l'office de complies : personne ne pouvait entrer ni sortir du quartier canonial durant la nuit.
-
 Porte-Moselle (paraige)
Porte-Moselle (paraige) Ce paraige, un des cinq paraiges originels, porte le nom du quartier nord de Metz, autour de la Porte-Moselle. Cette porte de l'enceinte antique s'ouvrait sur la route qui longe la Moselle vers Luxembourg et Trèves.
-
 Porte sculptée
Porte sculptée Le tympan de cette porte est sculptée aux armes de la famille Desch. Il ne reste aucune trace de polychromie mais l'écu, placé au cœur d'un motif végétal de type palmette, correspond à celui de cette famille. Il est associé à 7 guimbardes, symbole des Desch.
-
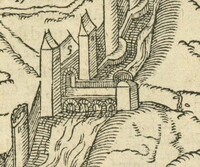 Porte Sainte-Barbe
Porte Sainte-Barbe La porte Sainte-Barbe était une des principales entrées fortifiées de Metz, construite au début du XIIIe siècle voire dans les dernières années du XIIe siècle. Elle s'ouvrait du côté du nord, au bout de la rue en Ayest, donnait sur le Pont Rengmont qui traversait la Seille et conduisait aux routes du nord vers Trêves et du nord-est, dit le Haut Chemin.
Au XIIIe siècle, la porte est appelée porte de Parnemaille du nom du faubourg situé de l'autre côté de la Seille. Elle prend le nom de porte du pont Rengmont au XVe siècle, puis de porte Sainte-Barbe au XVIe siècle, à cause de la popularité du pèlerinage à Sainte-Barbe, sanctuaire situé sur le Haut Chemin.
Comme la porte des Allemands, la porte Sainte-Barbe est régulièrement modernisée aux XIVe-XVIe siècles. Elle était initialement composée de deux tours protégeant une ouverture. Dès 1385, elle est doublée d'un ouvrage avancé sur la rive droite de la Seille, transformant le pont Rengmont en un pont fortifié (baile). Au XVe siècle, les deux tours sont découvertes pour aménager des plate-formes de tir, puis des canonnières sont percées.
En 1552, la construction du Retranchement de Guise en arrière de la porte la condamne à servir de carrière de pierres. Les derniers vestiges sont détruits en 1904.
-
 Porte des Allemands
Porte des Allemands Dans les années 1220, l'enceinte de Metz est considérablement agrandie, englobant le quartier d'Outre-Seille. La porte des Allemands devient alors l'une des grandes portes orientales de la cité : il prend le nom d'un hôpital tenu par les chevaliers teutoniques, un ordre de moines-chevaliers allemands. À partir de 1445, la porte est renforcée par un châtelet qui enjambe la Seille. Des travaux le modernisent au cours des XVe et XVIe siècles siècles. La porte des Allemands est la seule grande porte de Metz subsistant aujourd'hui.
-
 Porsaillis (paraige)
Porsaillis (paraige) Le lignage de Porsaillis est un des trois grands lignages de le chevalerie urbaine à la fin du XIIe siècle, et celui qui semble associé le plus étroitement au gouvernement épiscopal. Les membres du lignage s'opposent donc aux autres bourgeois qui souhaitent fonder une commune, et sont poussés deux fois à l'exil en 1215 et 1231, lors de la guerre des Amis qui voit leur défaite. Porsaillis prend ensuite place parmi les autres paraiges en accueillant des familles de marchands enrichis, et participe au gouvernement de la cité pendant trois siècles.
En 1355, le paraige de Porsaillis avait l'habitude de se réunir dans le cloître de Saint-Sauveur.
-
 Porche du parvis de Sainte-Ségolène
Porche du parvis de Sainte-Ségolène La façade de l'église Sainte-Ségolène est reconstruite à la fin du XVe siècle : elle donne sur une petite cour qui sert de parvis. Début XVIe siècle, la cour est fermée par un grand porche en style gothique flamboyant. Ce portail entre rue et parvis était surmonté d'un tympan où prenait place une statue de la patronne de la paroisse, sainte Ségolène, représentée en abbesse. Cette entrée était à son tour encadrée par un grand gâble (un pignon décoratif) qui s'élevait au-dessus d'une fine galerie à claire-voie et se terminait par une croix.
-
Pontifical de Constance (Metz, BM, ms. 334)
Constance (Allemagne)
-
Pont des Grilles de la Moselle
Le pont des Grilles, construit en 1360, complète les fortifications de Metz en protégeant le cours de la Moselle du côté aval. Il s'agit d'un pont couvert, constitué de quatre arches défendues par trois tours. Les arches contiennent des herses que l'on peut monter et descendre, fermant ainsi le cours de la rivière. le pont était aussi appelé « Rhinpont » (c'est-à-dire Pont du Rhin), car il se dressait au « Rhinport » (le port du Rhin) : l'aval de la Moselle permet de rejoindre la vallée du Rhin. Il était encore appelé « pont des Basses Grilles ».
Comme il ne permettait pas le passage des véhicules, le pont est démoli en 1745 et reconstruit. A cette occasion, on découvre une inscription commémorative de sa construction en 1360, que plusieurs érudits messins ont copiée.
-
Poirier, François-Jacques, « Notice sur l'ancienne paroisse de Saint-Simplice, de Metz »
Poirier, abbé François-Jacques , « Notice sur l'ancienne paroisse de Saint-Simplice, de Metz », Annuaire de la Société d'histoire et d'archéologie lorraine, 1892, p. 167-213.
-
Poincignon Le Gronnais (14..-1469)
Poincignon Le Gronnais est le fils de Renaud Le Gronnais et de Perrette Dieu-Ami. Il est le premier époux de Philippe, fille de Joffroy Desch et de Lorette de Herbévillers. Ce mariage sert à consolider le lien entre les deux familles, Lorette s'étant remariée avec le père de Poincignon à la mort de Joffroy Desch : on marie ainsi les enfants issus du premier lit. Mais le mariage est de courte durée, car Poincignon meurt jeune adulte le 18 avril 1469. À sa mort, il y a un long conflit de succession entre son épouse Philippe et les frères déshérités de Poincignon. Son corps est inhumé au couvent des Frères Prêcheurs.
-
Poincignon Le Braconnier (14..-15..)
L'ascendance de Poincignon Le Braconnier est inconnue. Il épouse une certaine Jacomette qui devient marraine d'une fille de Philippe de Vigneulles. Poincignon, marchand de Metz, occupe aussi la charge de clerc des « adjournés » entre 1483 et 1509, faisant de lui un membre clé du personnel officiel de la ville chargé de l'écrit, avec des gages annuels s'élevant à 60 sous. À Metz, les « adjournés » sont des procédures judiciaires expéditives réalisées devant un nombre restreint du conseil des Treize, parfois qu'un seul, et faisant intervenir qu'un petit nombre de plaideurs (six au maximum). Les « adjournés », qui concernaient les causes civiles de petite importance, se déroulaient au Palais des Treize en la « chambre des adjournés ». Poincignon meurt à une date inconnue entre 1509 et 1518.
-
Poincignon Dieu-Ami (13..-13..)
Poincignon Dieu-Ami est le seul enfant connu de Jean Dieu-Ami et de Jacomette. Il se marie en premières noces avec une certaine Mariette avant 1338. Veuf, il convole en secondes noces avec Jacomette Burchon entre 1355 et 1364. Veuf de nouveau, il se marie avec Alixette Mortel avant 1365. Sa descendance est issue de cette troisième union. Il fonde avec sa dernière épouse la chapelle Saint-Georges et Saint-Éloi dans l'église paroissiale Saint-Maximin, sans doute peu de temps après qu'il ait acquis la charge d'aman de la paroisse. Il meurt entre 1367 et 1375.
-
Poincignon de la Haie (14..-1483)
L'ascendance de Poincignon de la Haie nous est inconnue. Il épouse Perrette, fille de Jean Travalt dit l'Aîné de Porte-Moselle et de Collette Jaiquemat. Après une carrière active au sein du gouvernement muncipal, il meurt le 23 juillet 1483, sans doute encore assez jeune, laissant Perrette veuve. Aucune descendance ne lui est connue.
-
Poincette Grognat (13..-14..)
Poincette Grognat, fille de Nicolle et de Jennette Mortel, est la première épouse de Joffroy Desch. Leur mariage est célébré en 1415 ou avant. Elle meurt sans enfants à une date inconnue entre 1415 et 1426.
-
Poincette du Pont (12..-1310)
Poincette du Pont est la fille de Forquignon du Pont et d'une mère inconnue. La famille Desch serait issue de ce lignage affilié aux paraiges au XIIIe siècle. Elle épouse Philippin Thomas, aussi patricien de la cité. Elle meurt le 8 décembre 1310 et son corps est enseveli au couvent des Cordeliers.
-
Poincette Dieu-Ami (13..-13..)
Poincette Dieu-Ami est la fille de Poincignon Dieu-Ami et de Alixette Mortel. Elle épouse Joffroy Grognat avec qui elle a trois fils qui nous sont connus : Nicolle, Poince et Jacomin. Elle meurt veuve à une date inconnue après 1384.
 Porte-Moselle (paraige) Ce paraige, un des cinq paraiges originels, porte le nom du quartier nord de Metz, autour de la Porte-Moselle. Cette porte de l'enceinte antique s'ouvrait sur la route qui longe la Moselle vers Luxembourg et Trèves.
Porte-Moselle (paraige) Ce paraige, un des cinq paraiges originels, porte le nom du quartier nord de Metz, autour de la Porte-Moselle. Cette porte de l'enceinte antique s'ouvrait sur la route qui longe la Moselle vers Luxembourg et Trèves. Porte sculptée Le tympan de cette porte est sculptée aux armes de la famille Desch. Il ne reste aucune trace de polychromie mais l'écu, placé au cœur d'un motif végétal de type palmette, correspond à celui de cette famille. Il est associé à 7 guimbardes, symbole des Desch.
Porte sculptée Le tympan de cette porte est sculptée aux armes de la famille Desch. Il ne reste aucune trace de polychromie mais l'écu, placé au cœur d'un motif végétal de type palmette, correspond à celui de cette famille. Il est associé à 7 guimbardes, symbole des Desch.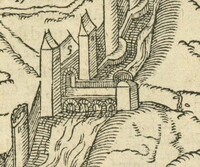 Porte Sainte-Barbe La porte Sainte-Barbe était une des principales entrées fortifiées de Metz, construite au début du XIIIe siècle voire dans les dernières années du XIIe siècle. Elle s'ouvrait du côté du nord, au bout de la rue en Ayest, donnait sur le Pont Rengmont qui traversait la Seille et conduisait aux routes du nord vers Trêves et du nord-est, dit le Haut Chemin. Au XIIIe siècle, la porte est appelée porte de Parnemaille du nom du faubourg situé de l'autre côté de la Seille. Elle prend le nom de porte du pont Rengmont au XVe siècle, puis de porte Sainte-Barbe au XVIe siècle, à cause de la popularité du pèlerinage à Sainte-Barbe, sanctuaire situé sur le Haut Chemin. Comme la porte des Allemands, la porte Sainte-Barbe est régulièrement modernisée aux XIVe-XVIe siècles. Elle était initialement composée de deux tours protégeant une ouverture. Dès 1385, elle est doublée d'un ouvrage avancé sur la rive droite de la Seille, transformant le pont Rengmont en un pont fortifié (baile). Au XVe siècle, les deux tours sont découvertes pour aménager des plate-formes de tir, puis des canonnières sont percées. En 1552, la construction du Retranchement de Guise en arrière de la porte la condamne à servir de carrière de pierres. Les derniers vestiges sont détruits en 1904.
Porte Sainte-Barbe La porte Sainte-Barbe était une des principales entrées fortifiées de Metz, construite au début du XIIIe siècle voire dans les dernières années du XIIe siècle. Elle s'ouvrait du côté du nord, au bout de la rue en Ayest, donnait sur le Pont Rengmont qui traversait la Seille et conduisait aux routes du nord vers Trêves et du nord-est, dit le Haut Chemin. Au XIIIe siècle, la porte est appelée porte de Parnemaille du nom du faubourg situé de l'autre côté de la Seille. Elle prend le nom de porte du pont Rengmont au XVe siècle, puis de porte Sainte-Barbe au XVIe siècle, à cause de la popularité du pèlerinage à Sainte-Barbe, sanctuaire situé sur le Haut Chemin. Comme la porte des Allemands, la porte Sainte-Barbe est régulièrement modernisée aux XIVe-XVIe siècles. Elle était initialement composée de deux tours protégeant une ouverture. Dès 1385, elle est doublée d'un ouvrage avancé sur la rive droite de la Seille, transformant le pont Rengmont en un pont fortifié (baile). Au XVe siècle, les deux tours sont découvertes pour aménager des plate-formes de tir, puis des canonnières sont percées. En 1552, la construction du Retranchement de Guise en arrière de la porte la condamne à servir de carrière de pierres. Les derniers vestiges sont détruits en 1904. Porte des Allemands Dans les années 1220, l'enceinte de Metz est considérablement agrandie, englobant le quartier d'Outre-Seille. La porte des Allemands devient alors l'une des grandes portes orientales de la cité : il prend le nom d'un hôpital tenu par les chevaliers teutoniques, un ordre de moines-chevaliers allemands. À partir de 1445, la porte est renforcée par un châtelet qui enjambe la Seille. Des travaux le modernisent au cours des XVe et XVIe siècles siècles. La porte des Allemands est la seule grande porte de Metz subsistant aujourd'hui.
Porte des Allemands Dans les années 1220, l'enceinte de Metz est considérablement agrandie, englobant le quartier d'Outre-Seille. La porte des Allemands devient alors l'une des grandes portes orientales de la cité : il prend le nom d'un hôpital tenu par les chevaliers teutoniques, un ordre de moines-chevaliers allemands. À partir de 1445, la porte est renforcée par un châtelet qui enjambe la Seille. Des travaux le modernisent au cours des XVe et XVIe siècles siècles. La porte des Allemands est la seule grande porte de Metz subsistant aujourd'hui. Porsaillis (paraige) Le lignage de Porsaillis est un des trois grands lignages de le chevalerie urbaine à la fin du XIIe siècle, et celui qui semble associé le plus étroitement au gouvernement épiscopal. Les membres du lignage s'opposent donc aux autres bourgeois qui souhaitent fonder une commune, et sont poussés deux fois à l'exil en 1215 et 1231, lors de la guerre des Amis qui voit leur défaite. Porsaillis prend ensuite place parmi les autres paraiges en accueillant des familles de marchands enrichis, et participe au gouvernement de la cité pendant trois siècles. En 1355, le paraige de Porsaillis avait l'habitude de se réunir dans le cloître de Saint-Sauveur.
Porsaillis (paraige) Le lignage de Porsaillis est un des trois grands lignages de le chevalerie urbaine à la fin du XIIe siècle, et celui qui semble associé le plus étroitement au gouvernement épiscopal. Les membres du lignage s'opposent donc aux autres bourgeois qui souhaitent fonder une commune, et sont poussés deux fois à l'exil en 1215 et 1231, lors de la guerre des Amis qui voit leur défaite. Porsaillis prend ensuite place parmi les autres paraiges en accueillant des familles de marchands enrichis, et participe au gouvernement de la cité pendant trois siècles. En 1355, le paraige de Porsaillis avait l'habitude de se réunir dans le cloître de Saint-Sauveur. Porche du parvis de Sainte-Ségolène La façade de l'église Sainte-Ségolène est reconstruite à la fin du XVe siècle : elle donne sur une petite cour qui sert de parvis. Début XVIe siècle, la cour est fermée par un grand porche en style gothique flamboyant. Ce portail entre rue et parvis était surmonté d'un tympan où prenait place une statue de la patronne de la paroisse, sainte Ségolène, représentée en abbesse. Cette entrée était à son tour encadrée par un grand gâble (un pignon décoratif) qui s'élevait au-dessus d'une fine galerie à claire-voie et se terminait par une croix.
Porche du parvis de Sainte-Ségolène La façade de l'église Sainte-Ségolène est reconstruite à la fin du XVe siècle : elle donne sur une petite cour qui sert de parvis. Début XVIe siècle, la cour est fermée par un grand porche en style gothique flamboyant. Ce portail entre rue et parvis était surmonté d'un tympan où prenait place une statue de la patronne de la paroisse, sainte Ségolène, représentée en abbesse. Cette entrée était à son tour encadrée par un grand gâble (un pignon décoratif) qui s'élevait au-dessus d'une fine galerie à claire-voie et se terminait par une croix.