-
Burthe Paillat dit le Jeune (13..-14..)
Burthe Paillat dit le Jeune est le fils de Burtignon Paillat et d'une mère qui nous est inconnue. Son épouse nous est également inconnue, mais il a deux fils : Collin et Louis. Il meurt après 1409.
-
Busby, Keith, Codex et contexte : lire la littérature médiévale française dans les manuscrits
Busby, Keith, Codex et contexte : lire la littérature médiévale française dans les manuscrits, trad. fr., Paris, 2022
-
 Buste d'homme à l'antique (Maison des têtes)
Buste d'homme à l'antique (Maison des têtes) Ce buste en haut-relief est une des cinq sculptures qui ont donné leur nom à la « Maison des têtes » au 33 en Fournirue, et qui étaient disposés sur le tympan de la fenêtre de l'étage noble de la maison. L'homme barbu a la chevelure bouclée retenue par une bandelette nouée sur la nuque et retombant sur l'épaule droite. Le vêtement, laissant la gorge dégagée, est retenu sur l'épaule gauche par une fibule ovale. Cette représentation à l'antique illustre la passion pour l'Antiquité des propriétaires de la maison. Le style de l'œuvre est proche de celui du sculpteur Ligier Richier, à qui on l'attribue parfois. Détaché de son architecture en 1913, ce buste avait été complété d'une base additionnelle (épaules et dos) permettant une présentation isolée, à la verticale, alors que l'originale était oblique par rapport à la fenêtre.
-
 Buste d'un Français (Maison des têtes)
Buste d'un Français (Maison des têtes) Ce buste en haut-relief est une des cinq sculptures qui ont donné leur nom à la « Maison des têtes » au 33 en Fournirue, et qui étaient disposés sur le tympan de la fenêtre de l'étage noble de la maison. Il s'agit du buste central de la façade. Le personnage est vêtu à la mode française de la Renaissance : il porte un chapeau large, une veste en tulle et une cape, ainsi qu'un médaillon circulaire autour du cou. Les bustes ont été déposés et vendus en 1913 : la maison est démolie au cours des années 1970 lors de la construction du centre Saint-Jacques. Ce buste avait été vendu à un collectionneur américain ; acquis par la gallerie Blumka à New York, il est vendu en 1962 au banquier et collectionneur Richard Thornton Wilson III (1886-1977). Celui-ci a été un grand donateur du Museum of Fine Arts de Boston ; le buste fait partie des legs donnés au musée en 1983 par son fils Richard Thornton Wilson Junior. L'attribution du buste à Ligier Richier n'est pas retenue par les spécialistes européens.
-
 Buste de femme (maison des têtes)
Buste de femme (maison des têtes) Ce buste en haut-relief était le deuxième à droite des cinq sculptures qui ont donné leur nom à la « Maison des têtes » au 33 en Fournirue, et qui étaient disposés sur le tympan de la fenêtre de l'étage noble de la maison. La femme est tourné vers le dernier personnage à droite, donnant l'effet d'un couple en pleine discussion. Sa coiffure est retenue par un bandeau que recouvre un voile laissant émerger, à la base, deux longues nattes. la gorge est protégée par une guimpe finement plissée, et que recouvre le noeud du voile, au contact de la robe. Sur l'épaule gauche, une fibule ovale.
-
 Buste de femme à l'antique (maison des têtes)
Buste de femme à l'antique (maison des têtes) Ce buste en haut-relief est le deuxième à gauche des cinq sculptures qui ont donné leur nom à la « Maison des têtes » au 33 en Fournirue, et qui étaient disposés sur le tympan de la fenêtre de l'étage noble de la maison. Cette femme était tourné vers l'homme à l'antique à sa gauche, donnant l'effet d'un couple en pleine discussion . La femme est vêtue à l'antique, un voile recouvrant sa tête. Sa coiffure savante est relevée et nouée au sommet du front, peut-être complétée de postiches sur les oreilles. Deux longues mèches retombent sur les épaules, mèches reliées par un bandeau noué sur la gorge. Une guimpe finement plissée protège la gorge. La tête, mutilée (nez) a été restaurée de manière approximative.
-
Buste-reliquaire de saint Étienne
En 1365, l'évêque Thierry Bayer enrichit la cathédrale d'un magnifique buste-reliquaire : une statue de vermeil ornée de pierres précieuses qui contient des reliques du saint patron de la cathédrale, saint Étienne, le premier des martyrs. Le buste est donné par l'empereur Charles IV de Luxembourg, qui le tenait lui-même du pape Urbain V.
Au XVe siècle, deux patriciens enrichissent le buste en offrant chacun un collier d'or : Poince Grognat en 1417 et Nicolle Louve en 1448.
-
Cailly, Charles « Communication sur la fresque des Trois morts au Petit-Clairvaux »
Cailly, Charles, « Communication sur la fresque des Trois morts au Petit-Clairvaux », Bulletin de la société archéologique de la Moselle, 1866, p. 74-77.
-
 Calice de Saint-Pierre-aux-Nonnains
Calice de Saint-Pierre-aux-Nonnains Ce calice en argent servait à célébrer la messe. Il a été trouvé, endommagé, dans le sarcophage d'un clerc. Ce dernier avait été enterré dans la chapelle sépulcrale qui se trouvait au nord-est de l'église Saint-Pierre. Au XVIe siècle, la tombe a été refaite et la pierre tombale ornée d'une croix d'abbé ou d'évêque et des initiales MT, mais on ignore l'identité du défunt, mort au XIVe ou au XVe siècle.
La tombe a été découverte lors des fouilles de l'archéologue allemand Reusch, en 1942-1944. Les vestiges de la chapelle ont été détruits pour ouvrir un passage entre Saint-Pierre-aux-Nonnains et l'auditorium de l'Arsenal.
Le calice est à coupe hémisphérique, avec une base en pavillon de trompette et un anneau à mi-hauteur du pied.
-
Camérier
L'office de camérier ou chambrier (camerarius en latin) fait partie des quatre offices de cloître mentionné dans le Cérémonial de la cathédrale de Metz, avec ceux d'intendant (ou de cellérier), de sénéchal et de percepteur.
La fonction de camérier n’apparaît qu’au cours de la Semaine Sainte : le Jeudi Saint, lors de la Sainte Cène, il doit prélever de la chambre du trésor deux cierges de 1 livre et demi ou 2 et les poser sur la grande table du réfectoire, ainsi que des petites chandelles, pesant chacune ½ livre de cire, qui sont à disposer sur les tables et sur le grand cierge en forme de colonne. Il doit également servir les chanoines le Vendredi saint au chapitre et au réfectoire, pour le Mandatum, avec l’intendant, le prévôt du réfectoire et le sénéchal. Il n’a aucun rôle particulier dans la liturgie proprement dite. Bien qu’il ait la charge de garder le trésor, ce n’est pas lui qui prépare les brancards à reliques ou qui orne la cathédrale lors des grandes fêtes.
-
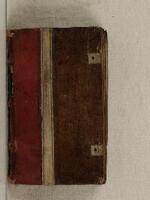 Cantique des cantiques et commentaires (Metz, BM, ms. 449)
Cantique des cantiques et commentaires (Metz, BM, ms. 449)
-
Cardinal
Le cardinal est un prince de l'Église catholique qui peut participer au gouvernement de l'Église catholique dans ses plus hautes sphères. Depuis le XIIIe siècle, les cardinaux se réunissent au sein d'un collège (Sacro Collège) à chaque élection du souverain pontife.
Ils ont la possibilité de se déplacer dans les diocèses en tant que légat pontifical pour représenter le pape dans les affaires ecclésiastiques. A l'époque médiévale, les cardinaux bénéficient d'un fort pouvoir temporel pour intervenir dans les conflits locaux, si mandatés par le pape. D'autre part, ils peuvent influencer la nomination d'un évêque.
-
 Carreau de pavement de Saint-Nicolas : couple dansant
Carreau de pavement de Saint-Nicolas : couple dansant Ce carreau de pavement provient des fouilles de l'hôpital Saint-Nicolas. Sa technique, la céramique glaçurée, illustre le luxe de l'établissement d'accueil. Le carreau représente peut-être une scène courtoise, un couple dansant.
-
 Carreau de poêle niche : le jeune noble
Carreau de poêle niche : le jeune noble Ce beau carreau de poêle a été découvert sur le site d'un atelier de potier. Il s'agit d'un carreau-niche, moulé autour d'une alvéole semi-cylindrique. Le personnage est en haut-relief sur un décor d'architecture de trilobes gothiques ornées de lancettes évidées. Le visage du personnage est jaune, et son chaperon noir. Il est représenté de face, les bras le long du corps. Son costume est celui d'un jeune noble : chaussé de poulaines, il porte un chaperon et un surcot court aux manches outrageusement longues qui lui descendent jusqu'aux mollets.
-
Castan, Auguste , Jean-Jacques Boissard, poète latin, dessinateur et antiquaire, enfant de Besançon et citoyen de Metz. Etude sur sa vie, ses ouvrages et ses portraits
Castan, Auguste , Jean-Jacques Boissard, poète latin, dessinateur et antiquaire, enfant de Besançon et citoyen de Metz. Etude sur sa vie, ses ouvrages et ses portraits, t-à-p. des Mémoires de la Société d'Emulation du Doubs, Besançon, 1875.
-
Catherine Barroy (14..-14..)
Catherine Barroy est l'une des deux filles de Jean Barroy et de Catherine Le Hungre. Elle épouse Guillaume Chaverson, dont elle est la deuxième femme. Le couple a deux enfants qui nous soient connus : Joffroy et Catherine. Cette dernière meurt mineure avant 1438, ensevelie au couvent des Cordeliers. Catherine meurt à une date inconnue entre 1420 et 1442, date à laquelle Guillaume est mentionné veuf.
-
Catherine Baudoche (13..-13..)
Catherine Baudoche est la fille de Nicolle Baudoche dit l'Ancien et de Seliziette Le Gronnais. Elle épouse Jean Renguillon qui meurt en 1363. La date de son décès est incertaine.
-
Catherine Baudoche (13..-1399)
Catherine Baudoche est la fille de Jean Baudoche et de Jennette de Heu. Elle épouse Laurent, fils de Maheu Le Gronnais dit Volgenel et Seliziette Renguillon. Laurent meurt en 1396 durant la bataille de Nicopolis qui avait opposé l'armée de croisés de Sigismond de Luxembourg, roi de Hongrie, aux troupes turques du sultan ottoman Bayezid Ier. Catherine meurt veuve le 4 octobre 1399, son corps est enseveli au couvent des Célestins.
-
Catherine Baudoche (14..-1474)
Catherine Baudoche est la fille de Poince Baudoche et de Marguerite de Vy. Elle est la première femme de Werry Roucel qu'elle épouse avant 1459. Son fils Nicolle décède en juillet 1473, puis Catherine le 2 août 1474 et sa fille Catherine Roucel le 27 août suivant. Son corps est inhumé au couvent des Célestins.
-
Catherine Bertrand (13..-13..)
Catherine Bertrand est la fille de François Bertrand et de Collette Porrée. Elle épouse en premières noces Jean, fils de Simonat de Chambre et de Marion Xullefert. Devenue veuve entre 1367 et 1375, elle convole en secondes noces avec Bertrand, fils de Simonat Sollatte et d'une certaine Perrette. Elle meurt après 1389, à une date inconnue. Aucune descendance n'est connue de ce deuxième mariage.
-
Catherine Chaverson (14..-1508)
Catherine Chaverson est la fille de Joffroy Chaverson et de Jennette Grognat. Elle se marie en premières noces avec Pierre Le Gronnais le 3 août 1467 dans l'église Saint-Gorgon. Après le décès de Pierre survenu le 26 juillet 1474, elle se marie en deuxièmes noces avec Nicolle Desch en octobre 1476. Une nouvelle fois veuve en 1487, elle se marie avec Louis de Lenoncourt le 7 janvier 1489, dont elle est la seconde épouse. Elle décède en juillet 1508. Elle donne des vitraux aux Récollets, connus par des relevés modernes.
-
Catherine Daniel (13..-13..)
Catherine Daniel est la fille de l'aman Cugnin Daniel et de Marguerite Papperel. Elle épouse Nicolle Drouin et meurt entre 1379 et 1395. Elle obtient en 1376 par testament la Grange Daniel (ou Grange d'Agneaux), située actuellement à Montigny-lès-Metz. La Grange passe ensuite aux mains de son époux qui en est le propriétaire en 1404.
-
Catherine de Chahanay (15..-1598)
Catherine est la fille de Antoine de Chahanay et de Aliénor de Dommartin. Elle épouse en premières noces Jacques, fils de Thiébaut Le Gronnais. Les Chahanay sont particulièrement liés aux familles des paraiges. Sa soeur Madeleine épouse Philippe Roucel, alors que son autre soeur Nicolle épouse Richard de Raigecourt. Devenue veuve entre 1542 et 1567, elle se remarie avec Nicolas de Landres le 31 janvier 1567. Veuve une nouvelle fois en 1583, elle meurt à son tour le 6 octobre 1598. Son corps est inhumé à Fléville.
-
Catherine de Créhange (15..-1544)
Catherine de Créhange est la fille de Jean baron de Créhange et de Puttelange et d'Ermengarde de Raville, issu d'un lignage de la Lorraine germanophone. Elle épouse Claude Le Gronnais le 5 février 1532. Elle meurt le laissant veuf le 6 novembre 1544. Sa sépulture se trouve en l'église Saint-Maximin dans la chapelle Saint-Éloi et Saint-Georges.
-
Catherine de Gorze (14..-1466)
Catherine de Gorze est la fille de Henri de Gorze et de Jacomette de Gorze, deux familles ou branches disctinces. Son lien avec les paraiges est attesté par le père de sa mère, Jean de Gorze, inscrit au Commun. Catherine épouse Didier Bertrand. Les deux époux meurent de peste en 1466 durant la grande épidémie qui ravage la ville au printemps et à l'été ; Catherine s'éteint le 24 juillet et Didier le 15 août, toujours sans descendance.
 Buste d'homme à l'antique (Maison des têtes) Ce buste en haut-relief est une des cinq sculptures qui ont donné leur nom à la « Maison des têtes » au 33 en Fournirue, et qui étaient disposés sur le tympan de la fenêtre de l'étage noble de la maison. L'homme barbu a la chevelure bouclée retenue par une bandelette nouée sur la nuque et retombant sur l'épaule droite. Le vêtement, laissant la gorge dégagée, est retenu sur l'épaule gauche par une fibule ovale. Cette représentation à l'antique illustre la passion pour l'Antiquité des propriétaires de la maison. Le style de l'œuvre est proche de celui du sculpteur Ligier Richier, à qui on l'attribue parfois. Détaché de son architecture en 1913, ce buste avait été complété d'une base additionnelle (épaules et dos) permettant une présentation isolée, à la verticale, alors que l'originale était oblique par rapport à la fenêtre.
Buste d'homme à l'antique (Maison des têtes) Ce buste en haut-relief est une des cinq sculptures qui ont donné leur nom à la « Maison des têtes » au 33 en Fournirue, et qui étaient disposés sur le tympan de la fenêtre de l'étage noble de la maison. L'homme barbu a la chevelure bouclée retenue par une bandelette nouée sur la nuque et retombant sur l'épaule droite. Le vêtement, laissant la gorge dégagée, est retenu sur l'épaule gauche par une fibule ovale. Cette représentation à l'antique illustre la passion pour l'Antiquité des propriétaires de la maison. Le style de l'œuvre est proche de celui du sculpteur Ligier Richier, à qui on l'attribue parfois. Détaché de son architecture en 1913, ce buste avait été complété d'une base additionnelle (épaules et dos) permettant une présentation isolée, à la verticale, alors que l'originale était oblique par rapport à la fenêtre. Buste d'un Français (Maison des têtes) Ce buste en haut-relief est une des cinq sculptures qui ont donné leur nom à la « Maison des têtes » au 33 en Fournirue, et qui étaient disposés sur le tympan de la fenêtre de l'étage noble de la maison. Il s'agit du buste central de la façade. Le personnage est vêtu à la mode française de la Renaissance : il porte un chapeau large, une veste en tulle et une cape, ainsi qu'un médaillon circulaire autour du cou. Les bustes ont été déposés et vendus en 1913 : la maison est démolie au cours des années 1970 lors de la construction du centre Saint-Jacques. Ce buste avait été vendu à un collectionneur américain ; acquis par la gallerie Blumka à New York, il est vendu en 1962 au banquier et collectionneur Richard Thornton Wilson III (1886-1977). Celui-ci a été un grand donateur du Museum of Fine Arts de Boston ; le buste fait partie des legs donnés au musée en 1983 par son fils Richard Thornton Wilson Junior. L'attribution du buste à Ligier Richier n'est pas retenue par les spécialistes européens.
Buste d'un Français (Maison des têtes) Ce buste en haut-relief est une des cinq sculptures qui ont donné leur nom à la « Maison des têtes » au 33 en Fournirue, et qui étaient disposés sur le tympan de la fenêtre de l'étage noble de la maison. Il s'agit du buste central de la façade. Le personnage est vêtu à la mode française de la Renaissance : il porte un chapeau large, une veste en tulle et une cape, ainsi qu'un médaillon circulaire autour du cou. Les bustes ont été déposés et vendus en 1913 : la maison est démolie au cours des années 1970 lors de la construction du centre Saint-Jacques. Ce buste avait été vendu à un collectionneur américain ; acquis par la gallerie Blumka à New York, il est vendu en 1962 au banquier et collectionneur Richard Thornton Wilson III (1886-1977). Celui-ci a été un grand donateur du Museum of Fine Arts de Boston ; le buste fait partie des legs donnés au musée en 1983 par son fils Richard Thornton Wilson Junior. L'attribution du buste à Ligier Richier n'est pas retenue par les spécialistes européens. Buste de femme (maison des têtes) Ce buste en haut-relief était le deuxième à droite des cinq sculptures qui ont donné leur nom à la « Maison des têtes » au 33 en Fournirue, et qui étaient disposés sur le tympan de la fenêtre de l'étage noble de la maison. La femme est tourné vers le dernier personnage à droite, donnant l'effet d'un couple en pleine discussion. Sa coiffure est retenue par un bandeau que recouvre un voile laissant émerger, à la base, deux longues nattes. la gorge est protégée par une guimpe finement plissée, et que recouvre le noeud du voile, au contact de la robe. Sur l'épaule gauche, une fibule ovale.
Buste de femme (maison des têtes) Ce buste en haut-relief était le deuxième à droite des cinq sculptures qui ont donné leur nom à la « Maison des têtes » au 33 en Fournirue, et qui étaient disposés sur le tympan de la fenêtre de l'étage noble de la maison. La femme est tourné vers le dernier personnage à droite, donnant l'effet d'un couple en pleine discussion. Sa coiffure est retenue par un bandeau que recouvre un voile laissant émerger, à la base, deux longues nattes. la gorge est protégée par une guimpe finement plissée, et que recouvre le noeud du voile, au contact de la robe. Sur l'épaule gauche, une fibule ovale. Buste de femme à l'antique (maison des têtes) Ce buste en haut-relief est le deuxième à gauche des cinq sculptures qui ont donné leur nom à la « Maison des têtes » au 33 en Fournirue, et qui étaient disposés sur le tympan de la fenêtre de l'étage noble de la maison. Cette femme était tourné vers l'homme à l'antique à sa gauche, donnant l'effet d'un couple en pleine discussion . La femme est vêtue à l'antique, un voile recouvrant sa tête. Sa coiffure savante est relevée et nouée au sommet du front, peut-être complétée de postiches sur les oreilles. Deux longues mèches retombent sur les épaules, mèches reliées par un bandeau noué sur la gorge. Une guimpe finement plissée protège la gorge. La tête, mutilée (nez) a été restaurée de manière approximative.
Buste de femme à l'antique (maison des têtes) Ce buste en haut-relief est le deuxième à gauche des cinq sculptures qui ont donné leur nom à la « Maison des têtes » au 33 en Fournirue, et qui étaient disposés sur le tympan de la fenêtre de l'étage noble de la maison. Cette femme était tourné vers l'homme à l'antique à sa gauche, donnant l'effet d'un couple en pleine discussion . La femme est vêtue à l'antique, un voile recouvrant sa tête. Sa coiffure savante est relevée et nouée au sommet du front, peut-être complétée de postiches sur les oreilles. Deux longues mèches retombent sur les épaules, mèches reliées par un bandeau noué sur la gorge. Une guimpe finement plissée protège la gorge. La tête, mutilée (nez) a été restaurée de manière approximative. Calice de Saint-Pierre-aux-Nonnains Ce calice en argent servait à célébrer la messe. Il a été trouvé, endommagé, dans le sarcophage d'un clerc. Ce dernier avait été enterré dans la chapelle sépulcrale qui se trouvait au nord-est de l'église Saint-Pierre. Au XVIe siècle, la tombe a été refaite et la pierre tombale ornée d'une croix d'abbé ou d'évêque et des initiales MT, mais on ignore l'identité du défunt, mort au XIVe ou au XVe siècle. La tombe a été découverte lors des fouilles de l'archéologue allemand Reusch, en 1942-1944. Les vestiges de la chapelle ont été détruits pour ouvrir un passage entre Saint-Pierre-aux-Nonnains et l'auditorium de l'Arsenal. Le calice est à coupe hémisphérique, avec une base en pavillon de trompette et un anneau à mi-hauteur du pied.
Calice de Saint-Pierre-aux-Nonnains Ce calice en argent servait à célébrer la messe. Il a été trouvé, endommagé, dans le sarcophage d'un clerc. Ce dernier avait été enterré dans la chapelle sépulcrale qui se trouvait au nord-est de l'église Saint-Pierre. Au XVIe siècle, la tombe a été refaite et la pierre tombale ornée d'une croix d'abbé ou d'évêque et des initiales MT, mais on ignore l'identité du défunt, mort au XIVe ou au XVe siècle. La tombe a été découverte lors des fouilles de l'archéologue allemand Reusch, en 1942-1944. Les vestiges de la chapelle ont été détruits pour ouvrir un passage entre Saint-Pierre-aux-Nonnains et l'auditorium de l'Arsenal. Le calice est à coupe hémisphérique, avec une base en pavillon de trompette et un anneau à mi-hauteur du pied.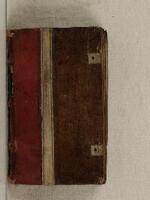 Cantique des cantiques et commentaires (Metz, BM, ms. 449)
Cantique des cantiques et commentaires (Metz, BM, ms. 449)  Carreau de pavement de Saint-Nicolas : couple dansant Ce carreau de pavement provient des fouilles de l'hôpital Saint-Nicolas. Sa technique, la céramique glaçurée, illustre le luxe de l'établissement d'accueil. Le carreau représente peut-être une scène courtoise, un couple dansant.
Carreau de pavement de Saint-Nicolas : couple dansant Ce carreau de pavement provient des fouilles de l'hôpital Saint-Nicolas. Sa technique, la céramique glaçurée, illustre le luxe de l'établissement d'accueil. Le carreau représente peut-être une scène courtoise, un couple dansant. Carreau de poêle niche : le jeune noble Ce beau carreau de poêle a été découvert sur le site d'un atelier de potier. Il s'agit d'un carreau-niche, moulé autour d'une alvéole semi-cylindrique. Le personnage est en haut-relief sur un décor d'architecture de trilobes gothiques ornées de lancettes évidées. Le visage du personnage est jaune, et son chaperon noir. Il est représenté de face, les bras le long du corps. Son costume est celui d'un jeune noble : chaussé de poulaines, il porte un chaperon et un surcot court aux manches outrageusement longues qui lui descendent jusqu'aux mollets.
Carreau de poêle niche : le jeune noble Ce beau carreau de poêle a été découvert sur le site d'un atelier de potier. Il s'agit d'un carreau-niche, moulé autour d'une alvéole semi-cylindrique. Le personnage est en haut-relief sur un décor d'architecture de trilobes gothiques ornées de lancettes évidées. Le visage du personnage est jaune, et son chaperon noir. Il est représenté de face, les bras le long du corps. Son costume est celui d'un jeune noble : chaussé de poulaines, il porte un chaperon et un surcot court aux manches outrageusement longues qui lui descendent jusqu'aux mollets.